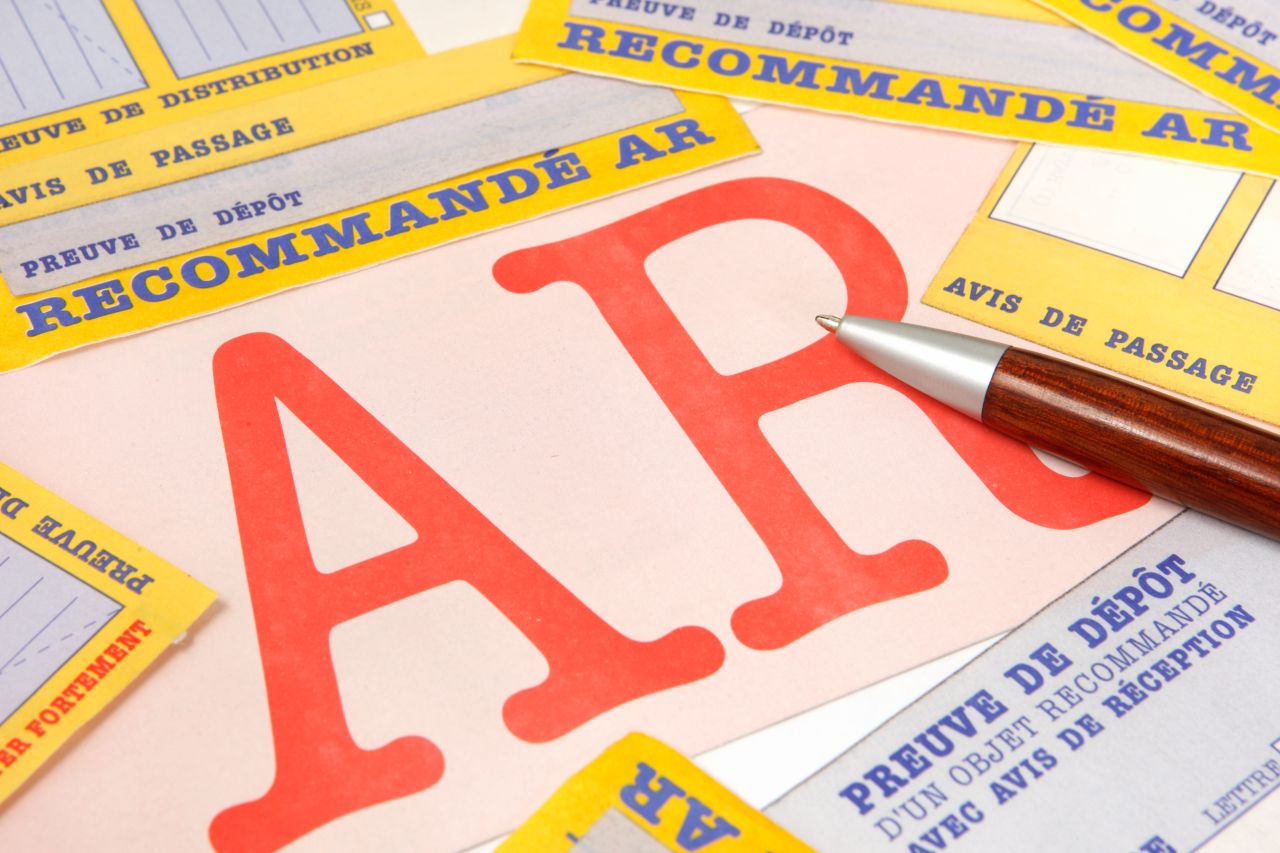En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Artificialisation des sols : consultation publique sur les projets de décrets précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN)
Les ministères de la transition écologique et de la transition énergétique ont ouvert,ce 13 juin 2023, une consultation publique sur les projets de décrets précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Analyse.
Résumé
Les projets de décrets soumis à consultation publique comportent de nombreuses mesures prises en application de la loi « climat-résilience » et notamment :
- La prise en compte dans les SRADDET des « efforts de réduction déjà réalisés » en matière de gestion économe et de réduction de l’artificialisation à partir des données observées sur la période 2011-2021 ou sur une période de vingt ans lorsque les données sont disponibles ;
- La prise en compte des particularités locales (communes littorale ou de montagne) et du désenclavement des territoires ;
- La garantie aux communes rurales (peu denses ou très peu denses) d’une surface minimale de développement ;
- La suppression de l’obligation de fixer une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET ;
- Une nouvelle nomenclature relative aux surfaces qualifiables de surfaces artificialisées, intégrant les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces ;
- La qualification de surfaces non artificialisées pour les surfaces accueillant des panneaux photovoltaïques, sous conditions, ainsi que les surfaces à usage de parc ou de jardin public.
Rappel du contexte. Le chapitre III de la loi du 22 août 2021 « climat-résilience » (n°2021-1104) a fixé l’objectif d’atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire doit être déclinée territorialement dans les différents documents de planification.
Pour la première période à savoir la première tranche de dix années suivant la promulgation de la loi (2021-2031), le rythme de l’artificialisation des sols est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation de ces espaces observée au cours des dix années précédentes (2011-2021). Ce rythme ne peut dépasser la moitié de la consommation de ces espaces observée au cours des dix années précédentes.
Deux décrets du 29 avril 2022 ont déjà été pris en application de cette loi :
- Le décret n°2022-762 a fixé des objectifs et des règles en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (« SRADDET » ci-après) ;
- Le décret n°2022-763 a instauré une nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
Par un discours au Congrès des maires de France du 24 novembre 2022, la Première ministre a annoncé des ajustements à cette réforme afin de « territorialiser et de différencier nos objectifs ».
Une proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires a enfin été adoptée par le Sénat le 16 mars 2023, en première lecture. Le texte a été transmis, pour examen, à l’Assemblée nationale.
Dans ce cadre, et en application de la loi « climat-résilience », deux projets de décrets ont été soumis à consultation publique le 13 juin 2023 et jusqu’au 3 juillet 2023.
I. Le projet de décret relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
Ce projet de décret met en œuvre la territorialisation des objectifs issus de la loi.
En premier lieu, le projet de décret modifie les objectifs du SRADDET en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols (cf. article R. 4251-3 du code général des collectivités territoriale). En ce sens, le projet :
- prévoit que les objectifs du SRADDET en la matière sont territorialement déclinés en considérant « les efforts de réduction déjà réalisés » ;
- ajoute que les objectifs prennent en compte les particularités géographiques locales (communes littorale ou de montagne) et le désenclavement des territoires.
- ajoute que les objectifs considèrent l’adaptation des territoires exposés à des risques naturels.
Le projet de décret introduit explicitement les notions de prise en compte des efforts passés et de spécificités locales.
Concernant les efforts passés déjà réalisés, le projet de décret précise que, pour la première tranche de dix années (2021-2031), ils sont pris en compte à partir des données observées sur les dix années précédant la promulgation de la loi « climat-résilience » ou le cas échéant sur une période de vingt ans lorsque les données sont disponibles.
En deuxième lieu, le projet de décret supprime la fixation obligatoire d’une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. Celle-ci figurait à l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales qui exigeait que pour chacune des règles territorialisées permettant d’assurer la déclinaison des objectifs, une cible d’artificialisation nette des sols soit déterminée.
Le rapport de présentation justifie cette suppression par l’adoption d’ « une approche plus proportionnée et qualitative du rôle de la région et ne pas conduire à contraindre de façon excessive les documents infrarégionaux ».
En troisième lieu, le projet prévoit que la déclinaison territoriale doit permettre de garantir aux communes rurales une surface minimale de développement. En ce sens, les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ne peuvent avoir pour effet de priver une commune peu dense ou très peu dense d’une capacité de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en-deçà d’une surface minimale de développement communal, tant au niveau du SRADDET que du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Cette surface minimale n’est pas précisée par le projet. En revanche, la proposition de loi, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, fait était d’une surface minimale de développement communal ne pouvant être inférieure à un hectare.
II. Le projet de décret relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
Ce projet de décret fixe les conditions d’application de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales.
En premier lieu, rappelons que l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme a été introduit par l’article 192 de la loi « climat-résilience » et a défini le processus d’artificialisation des sols et déterminé les surfaces devant être considérées comme artificialisées ou non artificialisées. Le décret n°2022-763 précité a fixé les conditions d’application de cet article. Une nomenclature annexée à ce décret a précisé les surfaces qualifiables de surfaces artificialisées.
D’une part, le projet de décret soumis à consultation publique précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l’évaluation du solde d’artificialisation nette des sols (flux). L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de références fixés dans la nomenclature annexée.
Une nouvelle nomenclature est ainsi annexée à ce projet de décret remplaçant celle résultant du décret n°2022-763. Sont intégrés les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces d’artificialisées ou de non artificialisées (50 m² pour le bâti et 2 500 m² pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25% de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas considérée comme herbacée). Ainsi, seront considérées comme des surfaces artificialisées les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti, supérieur ou égal à 50 m² d’emprise au sol.
Cette nomenclature ne s’appliquera pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans. Pendant la période 2021-2031, les objectifs porteront sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La notice du projet de décret précise que cette nomenclature n’a pas vocation à s’appliquer au niveau d’un projet. Les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire sont tout de même susceptibles de prendre en compte ces objectifs dans leur appréciation. A notre connaissance, le juge administratif ne s’est pas prononcé sur le sujet.
D’autre part, le projet de décret précise que peuvent être considérées comme des surfaces non artificialisées les surfaces dont les sols sont végétalisés et :
- soit sur lesquelles sont implantées des installations de production d’énergie solaire photovoltaïques. Ces installations devront respecter des critères fixés par un futur décret et notamment ceux relatifs à l’agrivoltaïsme (article L. 111-27 du code de l’urbanisme) et relatifs aux installations compatibles avec une activité agricole (article L. 111-29 du même code) ;
- soit sont à usage de parc ou de jardin public.
En second lieu, l’article 206 de la loi « climat-résilience » a introduit un nouvel article L. 2231-1 dans le code général des collectivités territoriales prévoyant l’obligation pour le maire notamment couvert par un document d’urbanisme d’établir un rapport tous les trois ans qui présente le rythme d’artificialisation sur son territoire, et de rendre compte de l’atteinte des objectifs fixés en termes de réduction de l’artificialisation. Cet article dispose qu’un décret détaillera les indicateurs et les données à faire figurer dans ce rapport.
C’est notamment l’objet du présent projet de décret. Le rapport doit présenter les indicateurs et données suivantes : la consommation des espaces ; le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées ; les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables ; l’évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces.
La réalisation de ce rapport s’appuie sur des données mesurables et accessibles. Les communes et établissement publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l’observatoire de l’artificialisation.
Une disposition transitoire est enfin prévue pour les indicateurs que les communes ou intercommunalités ne pourraient pas être en mesure de remplir, en l’absence de données durant les prochaines années. La notice du projet indique que ces suivis permettront d’apprécier l’artificialisation des sols à une échelle plus fine.
Finalement, ces projets de décrets poursuivent la construction du nouveau cadre juridique du zéro artificialisation nette, en prenant notamment en compte les dernières annonces du gouvernement et du Ministre de la transition écologique.
Caroline Grenet
Avocate – cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : un « stress-test » pour la Charte de l’environnement à l’occasion de son 20ème anniversaire (loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur »)
Ce 8 juillet 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" dite "Loi Duplomb" du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci...
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi mais le risque d’un « moratoire light » sur les énergies renouvelables demeure
Ce mardi 24 juin 2025, les députés doivent se prononcer, lors du vote solennel, pour ou contre la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si le texte est rejeté par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.