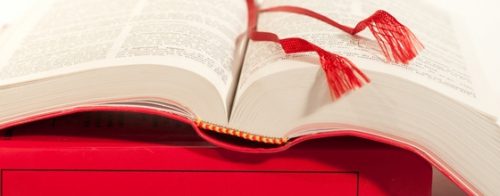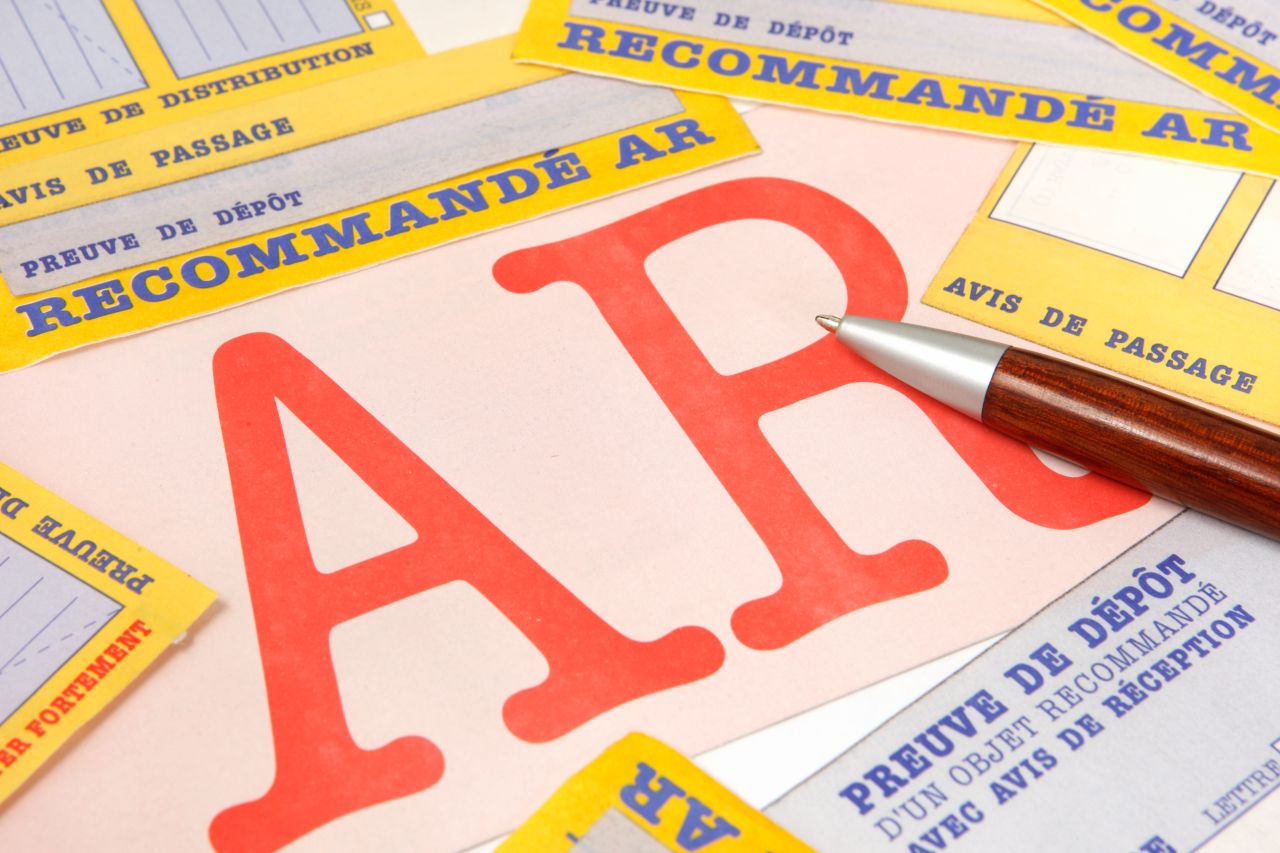En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Dialogue environnemental : le projet d’ordonnance est soumis à consultation publique
Le ministère de l’environnement vient d’ouvrir une consultation publique en ligne sur le projet d’ordonnance « portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions susceptibles d’affecter l’environnement« . Présentation.
Ce projet d’ordonnance a été pris en application de l’article 106 de la loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il a pour objet de donner une suite au rapport issu des travaux de la commission sur la modernisation du dialogue environnemental, présidée par le sénateur Alain Richard et dont Arnaud Gossement était expert qualifié.
De manière générale, ce projet d’ordonnance a pour principal intérêt de renforcer le rôle et l’indépendance de la Commission nationale du débat public, désormais dénommée « Haute autorité de la participation citoyenne ». Le projet d’ordonnance prévoit également la création d’une procédure de concertation préalable dont le champ d’application devrait toutefois, s’agissant des projets, être très limité.
Ce projet de texte comporte les éléments principaux suivants :
1. La définition du contenu du principe de participation du public à l’article L.120-1 du code de l’environnement
2. La création d’une « Haute autorité de la participation citoyenne » qui vient se substituer à la Commission nationale du débat public (articles L.121-1 et s du code de l’environnement)
3. La création d’une nouvelle de procédure de « concertation préalable » (articles L.121-6 et s du code de l’environnement)
4. le développement de la dématérialisation des enquêtes publiques (articles L.123-10 et s du code de l’environnement.
La présente note n’a pas vocation à être exhaustive mais uniquement à mettre en relief certains éléments du projet d’ordonnance.
I. Le contenu du principe de participation du public
Le projet d’ordonnance prévoit tout d’abord de rédiger l’article L.121-1 du code de l’environnement de la manière suivante :
« Art. L. 120-1 – I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mis en œuvre en vue :
« 1° d’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
« 2° d’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
« 3° de sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ;
« 4° d’améliorer et de diversifier l’information environnementale.
« II. – La participation confère le droit pour le public :
« 1° d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
« 2° de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre premier ;
« 3° de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et propositions ;
« 4° d’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.
« III. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre.
« Elles s’appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.«
On notera que cette définition du contenu du principe de participation du public est très prudente. Cette disposition ne prévoit en effet pas précisément que l’administration doit tenir compte de l’avis du public (par la motivation des décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation). Il est prévu une information du public sur ‘la manière dont il a été tenu compte » des observations du public.
II. La création d’une « Haute autorité de la participation citoyenne » (articles L.121-1 et s du code de l’environnement)
La version du projet d’ordonnance soumise à la consultation publique va plus loin que les versions précédentes par la création de la Haute autorité de la participation citoyenne. Les auteurs du projet d’ordonnance reprennent ici une idée défendue par les représentants des associations de protection de l’environnement au sein de la commission présidée par M Alain Richard.
On notera que la Haute autorité de la participation citoyenne
– est une autorité administrative indépendante (article L.121-1 du code de l’environnement);
– veille au respect de la participation du public pour l’élaboration de projets listés par décret jusqu’à réception des équipements et travaux ;
– veille au respect de la participation du public pour l’élaboration des plans et programmes de niveau national ou mentionnés à l’article L.121-8 du code de l’environnement, jusqu’à leur adoption ou approbation ;
– établit une liste nationale et publique de garants de la participation du public ;
– peut assurer une mission de conciliation
Dans l’ensemble, les dispositions du projet d’ordonnance sont encore très générales, ce dont on ne lui fera pas nécessairement grief. Il convient d’attendre les décrets d’application pour savoir précisément comment la Haute autorité exercera concrètement sa mission de contrôle du respect du principe de participation du public et sa mission de conciliation.
Dans leur principe, ces deux missions sont très intéressantes. Il serait en effet utile de régler des litiges devant cette Haute autorité plutôt que d’avoir à en débattre tout de suite devant le juge administratif.
III. La création d’une nouvelle de procédure de « concertation préalable » (articles L.121-6 et s du code de l’environnement)
Il devait s’agir de l’élément central de ce projet d’ordonnance. Cette nouvelle procédure est destinée à répondre à la critique selon laquelle le public ne serait pas consulté suffisamment en amont de la décision relative à la réalisation d’un projet ou d’un plan/programme.
La problématique est la suivante : soit le public est consulté très en amont et le risque est qu’il ne soit rend destinataire que d’informations trés superficielles sur ce qui n’est encore qu’un avant-projet; soit il est consulté plus en aval et le risque est qu’il soit consulté sur un projet très avancé. Le traitement de cette problématique est complexe : il convient en effet de ne pas rendre plus longues et plus complexes les procédures d’autorisation, par la création d’une procédure de pré-autorisation qui pourrait de surcroît générer de nouveaux risques juridiques sans nécessairement améliorer l’information et la participation du public.
Un champ d’application limité. Dans la pratique, cette nouvelle procédure de concertation préalable est complexe et, sans doute, d’une application limitée.
Le futur article L.121-16 du code de l’environnement devrait préciser que peuvent faire l’objet d’une telle concertation préalable
– les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Haute autorité de la participation citoyenne en application de l’article L. 121-8-1.
– les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et n’entrant pas dans les critères définis au I et II de l’article L. 121-8.
Il convient donc d’attendre les décrets d’application pour savoir quels sont exactement les plans, programmes et projets qui relèveront soit de la compétence de la Haute autorité, soit de la procédure de concertation préalable
Il convient également de souligner que les plans, programmes et projets visés à l’article L.121-16 « peuvent » faire l’objet d’une concertation préalable. Ils peuvent donc en être exonérés en fonction d’autres considérations.
Par ailleurs, ce même article L.121-16 précise tout de suite que certains documents d’urbanisme sont « exemptés » de cette procédure de concertation préalable :
« Sont exemptés d’une telle concertation les documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 120-2 et les plans et programmes suivants, respectant, en application des dispositions particulières qui les régissent, les dispositions définies à l’article L. 120-1 :
« – les plans de prévention des risques technologiques ;
« – les plans de gestion des risques inondations ;
« – les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
« – les plans d’action pour le milieu marin. »
En outre, il convient de préciser que seuls seront soumis à concertation préalable les projets soumis à la réalisation d’une déclaration d’intention par le maître d’ouvrage. Or, seuls les projets sous maîtrise d’ouvrage publique ou faisant l ‘objet de subventions publiques et d’un coût supérieur à un seuil à fixer par décret entreront dans le champ d’application de l’obligation de déclaration d’intention. Un seuil de 5 millions d’euros HT était mentionné dans la version du projet d’ordonnance diffusée en janvier 2016. Aussi, dans les faits, la plupart des projets sous maîtrise d’ouvrage privée devrait être exemptés de cette procédure de concertation préalable.
La déclaration d’intention. Le futur article L.121-17 du code de l’environnement précise de quelles manières doit être réalisée la déclaration d’intention pour les plans, programmes et projets entrant dans son champ d’application.
– Première hypothèse : la déclaration d’intention est réalisée par le maître d’ouvrage d’un projet concerné. Elle doit comporter les éléments listés à l’article L.121-17 I.
– Deuxième hypothèse : le projet a fait l’objet d’une décision de cas par cas imposant une étude d’impact, laquelle vaut déclaration d’intention
– Troisième hypothèse : pour les plans et programmes concernés, « l’acte prescrivant leur élaboration, ou à défaut, tout acte initiant la procédure d’élaboration d’un tel plan ou programme vaut déclaration d’intention dès lors qu’il est publié sur un site internet ».
Le droit d’initiative. La déclaration d’intervention est une condition nécessaire mais non suffisante pour qu’une concertation préalable soit organisée. Sans déclaration d’intention, la concertation préalable ne peut être organisée. Avec une déclaration d’intention, la concertation peut être organisée. Lorsque cette déclaration est intervenue, il convient de distinguer deux hypothèses
– Première hypothèse : le maître d’ouvrage ou la personne responsable d’un plan/programme décide d’organiser une concertation préalable : celle-ci sera organisée
– Deuxième hypothèse : le maître d’ouvrage ou la personne responsable d’un plan/programme ne décide pas d’organiser une concertation préalable. Dans ce cas : l’autorité administrative compétente peut imposer cette concertation (futur article L.121-18 du code de l’environnement). En outre, d’autres personnes peuvent demander à cette autorité administrative d’imposer cette concertation préalable. Ces personnes sont celles mentionnées par le futur article L.121-19 du code de l’environnement :
« Pour ces plans, programmes ou projets, peuvent saisir le représentant de l’État concerné :
« 1° 20 % d’électeurs inscrits sur les listes électorales des communes ou 10 % d’électeurs inscrits sur les listes électorales d’une région ou d’un département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui susceptible d’être affecté par le projet ;
« 2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui susceptible d’être affecté par le projet ;
« 3° Une association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d’associations agréée(s) au titre de l’article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui susceptible d’être affecté par le projet.«
A noter : le représentant de l’Etat n’est pas obligé de réserver une suite favorable à une demande (recevable) d’organisation de concertation préalable
« Le représentant de l’Etat décide de l’opportunité d’organiser une concertation préalable selon les modalités du I de l’article L. 121-16 et de l’article L. 121-20 et, dans ce cas, fixe la durée et l’échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l’Etat est réputé avoir rejeté la demande.«
Il convient donc de souligner que les conditions sont nombreuses pour qu’un projet ou un plan/programme fasse l’objet d’une concertation préalable.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Pesticides : le Gouvernement réduit l’indépendance de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES – décret n° 2025-629 du 8 juillet 2025)
Par un décret n°2025-629 du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, le Gouvernement a imposé par voie réglementaire une mesure qu'il n'avait pas réussi à imposer par voie législative, lors de la...
« Loi Duplomb » : un « stress-test » pour la Charte de l’environnement à l’occasion de son 20ème anniversaire (loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur »)
Ce 8 juillet 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" dite "Loi Duplomb" du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci...
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.