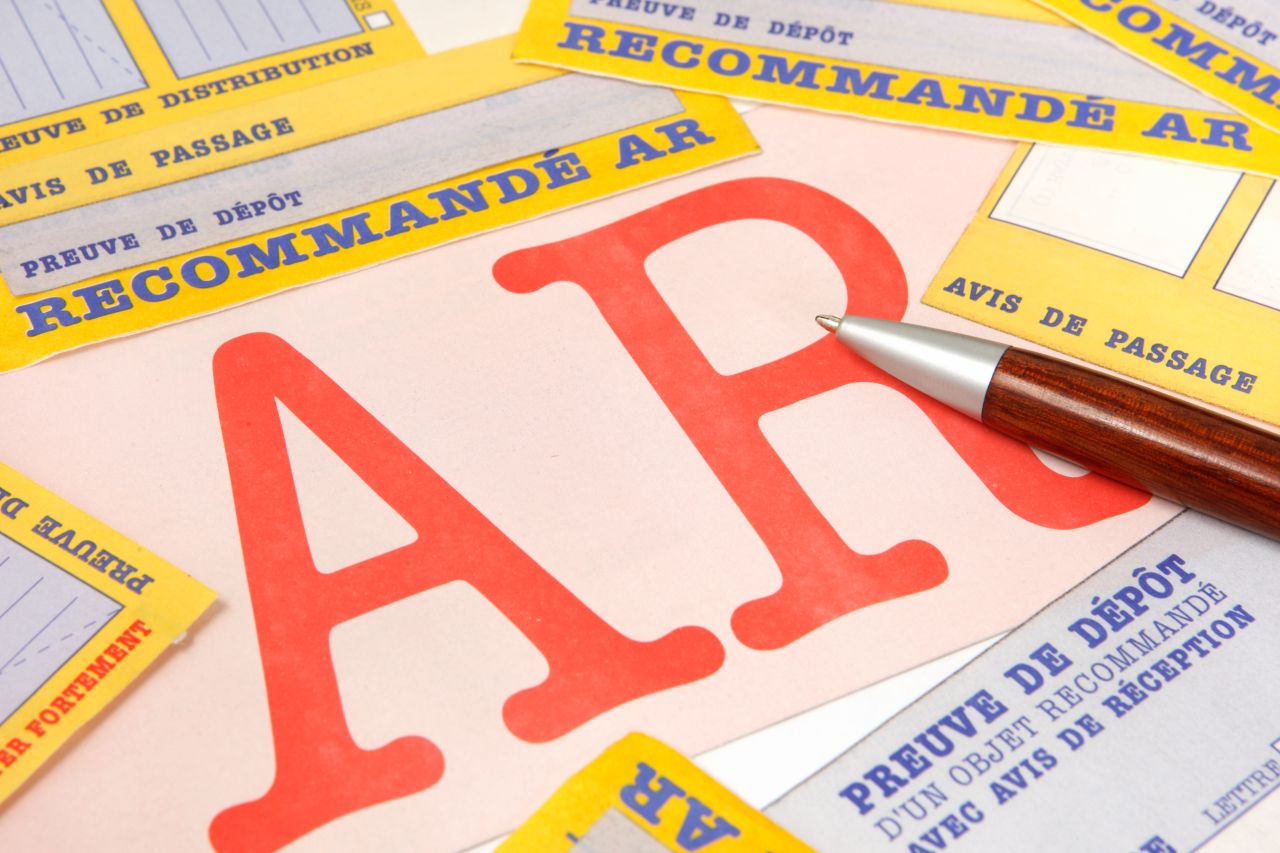En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Ouverture d’une consultation publique sur un projet de « Charte de la participation du public »
Le ministère de l’environnement vient d’ouvrir une consultation publique sur un projet de « Charte de la participation du public ». Analyse d’un texte à la valeur juridique incertaine.
De manière générale, cette Charte propose d’organiser la participation du public en encourageant les porteurs de projets à la signer et à prendre ainsi à leur charge des obligations volontaires qui peuvent aller au-delà du droit existant.
D’une rédaction et d’une valeur juridique très imprécises, cette Charte ne contribue pas à la sécurité juridique des projets ni à la simplification du droit. Dès l’instant où la Charte constitutionnelle de l’environnement prévoit que le principe de participation du public ne peut être décliné que par la loi, cette charte ne peut améliorer véritablement les conditions du dialogue environnemental.
Le recours à la charte de préférence à la loi. Cette « Charte de la participation du public » sera élaborée sans participation du Parlement.
Le préambule du projet de Charte de la participation du public précise que l’objet de ce texte sera d’organiser les conditions d’organisation de la participation du public :
« La Charte de la participation précise les valeurs et principes définissant le socle commun et intangible de tout processus participatif. Elle réaffirme et précise des droits et des devoirs pour tous les acteurs – le porteur de projet comme le public – de manière équivalente et réciproque. »
Pourtant, l’article 7 de la Charte de l’environnement précise clairement qu’il appartient à la loi et donc au Parlement d’organiser l’application du principe de participation du public :
« Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Aux termes de cet article 7, les conditions d’application du principe de la participation du public doivent être définies par la loi et donc par le Parlement. Cette Charte ne peut donc légalement organiser les conditions d’application du principe constitutionnel de participation du public. De deux choses l’une :
– soit cette Charte n’a qu’une valeur purement déclarative et n’est aucunement contraignante : son texte semble toutefois indiquer que telle n’est pas l’intention de ces rédacteurs. A défaut, l’utilité de ce texte serait en effet très relative.
– soit cette Charte possède une valeur juridique : elle est alors, notamment, contraire aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Pour contourner cette difficulté – rédiger un texte qui ne soit pas purement déclaratif sans toutefois recourir à la loi -, le projet de Charte propose de faire dépendre la valeur juridique de ses engagements du porteur de projet : ce dernier est appelé à créer une obligation volontaire en signant ce texte. Les engagements ainsi pris pourront lui être opposés.
Alors qu’une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale pour traiter de cet enjeu, il est sans doute regrettable que le Gouvernement choisisse de procéder à la rédaction d’une Charte, sans débat parlementaire rigoureux et approfondi sur un sujet aussi important. Il est difficile de penser que la démocratie participative peut évoluer au moyen d’une simple Charte élaborée sans les acteurs de la démocratie représentative.
La valeur juridique incertaine de la « Charte de la participation du public ». Il est difficile, à la lecture du projet de Charte et de son annexe de préciser la valeur juridique exacte de ce texte.
Il serait toutefois imprudent d’analyser ce texte comme dépourvu de toute valeur juridique.
En premier lieu, l’annexe de la Charte semble indiquer que celle-ci n’aura pas qu’une valeur purement déclarative mais sera « complémentaire aux dispositions légales et réglementaires existantes » :
« Le préambule, ainsi que les articles 1 à 4 de la Charte de la participation du public constituent un référentiel déterminant le socle commun et intangible de tout processus participatif.
Les valeurs et principes énoncés dans la Charte constituent un complément aux dispositions légales et réglementaires existantes, avec lesquelles elles convergent pour œuvrer à l’amélioration de la culture de la participation. » (nous soulignons).
Il est délicat de préciser le sens de ce que signifie l’expression « complément aux dispositions légales et réglementaires existantes« . Mais l’on voit mal comment un texte dépourvu de toute valeur juridique pourrait être un complément à un texte doté d’une valeur juridique. Si cette Charte n’a d’autre but que de proposer une interprétation de normes existante, il serait alors précieux de ne pas utiliser le terme « complément » et de préciser quels sont les textes interprétés.
En deuxième lieu, la Charte ne peut être considérée comme purement interprétative. Elle créé en effet de nouvelles règles par rapport au droit existant, comme nous le verrons plus loin.
En troisième lieu, la Charte propose aux porteurs de projet de donner eux-même une valeur juridique à ce texte en le signant, voire en le complétant. De cette manière, les porteurs de projets s’obligent eux-mêmes :
Le préambule du projet de Charte précise :
« Le porteur du projet, signataire de la présente Charte s’engage volontairement à conduire une participation sur tout projet qui modifie sensiblement le cadre de vie de la population et à mobiliser les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.«
« Ceux-ci s’engagent, par leur signature, à en respecter les valeurs et principes.«
Nul doute que les porteurs de projets seront fortement encouragés, notamment par les opposants, à signer cette Charte de la participation du public, voire à s’engager plus encore que ne le prévoit la Charte.
Or, en signant cette Charte, lesdits porteurs de projets s’obligent eux-mêmes. Et leur engagement pourra leur être opposé, par les opposant, l’administration voire le Juge.
Les obligations volontaires créées par la Charte. Ce projet de Charte procède de la théorie de l’obligation volontaire : en la signant, le porteur de projet s’oblige lui-même à respecter des engagements qui ne figurent pas dans les dispositions légales et réglementaires applicables. Et ses engagements pourront lui être opposés.
Ainsi l’annexe de la Charte organise un dispositif d' »endossement ». Le porteur peut signer, voire ajouter des engagements à ceux déjà prévus par la Charte :
« La Charte de la participation du public peut être utilisée de deux manières :
1. La Charte-référentiel » est signée en l’état par les organismes et individus se reconnaissant dans les valeurs et principes qu’elle énonce, et souhaitant les mettre effectivement en œuvre ou les promouvoir. Leur signature figurera, sous la forme de l’apposition de leur logo ou de leur signature électronique, sur le site internet dédié du ministère chargé de l’environnement.
Ils participent ainsi à un mouvement d’ensemble traduisant la volonté de développer et généraliser la culture de la participation du public.
2. Sans que le socle commun et intangible ne soit modifié, la Charte-référentiel est complétée, précisée par projet, par territoire, ou par organisme se reconnaissant dans les valeurs et principes qu’elle énonce, et souhaitant les mettre effectivement en œuvre. Elle devra alors bien préciser le champ sur lequel elle s’applique (projet et/ou territoire et/ou organisme).
Les signataires de cette nouvelle charte ainsi déclinée seront ajoutés aux signataires de la Charte-référentiel qu’ils auront de fait endossée.‘
La Cour d’appel de Versailles a pu ainsi rappeler qu’un opérateur de téléphonie mobile peut se voir opposer les engagements pris aux termes de « chartes » signées avec les élus locaux. Son arrêt rendu le 4 février 2009 précise ainsi :
« Qu’en espèce, la société X n’a pas mis en oeuvre dans le cadre de cette implantation, les mesures spécifiques ou effectives qu’elle est capable techniquement de mettre en oeuvre ainsi que l’établit la signature de chartes entre certaines communes et les opérateurs de téléphonie mobile qui fixent des normes d’émission bien en deçà des normes actuellement en vigueur en France ou qui éloignent les antennes mobiles des zones d’habitation ; » (nous soulignons).
Devant le Juge administratif saisi d’un recours en annulation d’une autorisation administrative contribuant à la réalisation du projet, le contenu de la Charte de la participation du public, a fortiori si elle a été signée, pourra être discuté par les parties de plusieurs manières. Elle pourra être opposée à l’argumentaire de l’administration ou du porteur de projet ou contribuer à l’interprétation des normes applicables à la participation du public.
Les obligations volontaires nouvelles. le projet de Charte comporte plusieurs engagements qui vont au-delà de ce que prévoit le droit actuel.
Ainsi, l’article 1er du projet de Charte prévoit :
« Le dispositif de garantie – Pour assurer la qualité du dialogue et la confiance entre le public et le porteur de projet, la participation respecte un objectif de neutralité et d’impartialité. Le porteur de projet met en place un dispositif qui permet de garantir l’atteinte de ces objectifs tout au long du processus participatif.
« Le bilan du processus participatif – Toute étape clé du processus participatif donne lieu à un bilan du porteur de projet. Par ailleurs, le dispositif de garantie intègre la production d’un bilan, qui résume la façon dont s’est déroulée la participation, actant les consensus et les dissensus résultant des débats. Ce bilan est remis au porteur de projet, ou au décisionnaire, au titre des éléments préparatoires à son choix final. Il fait l’objet d’une diffusion large auprès du public.
La reddition de comptes – Le porteur de projet explicite, en la motivant, la manière dont il a pris en compte ou non les contributions du public dans son choix final. »
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le porteur de projet est appelé à mettre en place un « dispositif de garantie » qui : garantit la neutralité et de l’impartialité du processus participatif et comprend un bilan de la participation du public. Le porteur de projet est également appelé à rédiger un document exposant la manière dont il a pris en compte les contributions du public dans son choix final.
Une rédaction imprécise. La qualité d’écriture juridique de ce projet de Charte n’est pas entièrement satisfaisante. Créant ainsi un risque de controverse d’interprétation de ses termes.
Si certaines dispositions sont purement déclaratives, d’autres sont surtout imprécises.
Ainsi, s’agissant du moment de la participation du public : » La participation du public intervient suffisamment en amont, tout au long de l’élaboration d’un projet. Au minimum, un retour régulier vers les citoyens est prévu au cours de la mise en œuvre du projet« . Les expressions « suffisamment en amont » ou « retour régulier » sont imprécises. Et l’on peut douter de leur utilités dès l’instant où cette Charte ne peut modifier les dispositions légales et réglementaires qui précisent à quel instant doivent être organisés les débats publics ou les enquêtes publiques.
Conclusion. Avant de procéder à l’écriture d’une telle charte, il aurait été préférable d’étudier les possibilités de simplification et de clarification des lois et règlements actuellement applicables à la participation du public.
En définitive, cette charte procède d’une confusion entre deux processus :
– les processus de participation organisés de manière volontaire : le porteur de projet organise de sa propre initiative la participation du public en dehors des procédures de participation obligatoires (débats publics, enquêtes publiques…) ;
– les processus de participation organisés de manière obligatoire : l’administration et le porteur de projet doivent organiser la participation du public dans le cadre des lois et règlements qui organisent ces procédures.
Tenter d’améliorer les processus obligatoires par le recours aux obligations volontaires et sans avoir au préalable prévu clairement cette possibilité par la loi est discutable. Et peut contribuer un peu plus à renforcer le sentiment de certains porteurs de projets que la participation du public est une source d’insécurité juridique et de vices de procédure.
En toute hypothèse, si cette Charte devait être publiée, il appartiendra aux maîtres d’ouvrages et pétitionnaires d’en intégrer le contenu dans leur analyse des risques juridiques.
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : un « stress-test » pour la Charte de l’environnement à l’occasion de son 20ème anniversaire (loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur »)
Ce 8 juillet 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" dite "Loi Duplomb" du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci...
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi mais le risque d’un « moratoire light » sur les énergies renouvelables demeure
Ce mardi 24 juin 2025, les députés doivent se prononcer, lors du vote solennel, pour ou contre la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si le texte est rejeté par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.