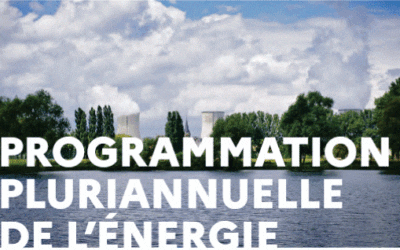En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Principe de précaution : une opération qui méconnait les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 8 avril 2019 (n° 411862), le Conseil d’Etat juge que dans l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou la santé justifiant l’application du principe de précaution, les autorités publiques ne peuvent déclarer une opération d’utilité publique qu’après avoir mis en place des procédures d’évaluation du risque identifié et vérifié que les mesures de précaution prises afin d’éviter la réalisation du dommage ne soient ni insuffisantes, ni excessives.
Résumé
- En présence d’un risque grave et irréversible pour l’environnement ou la santé établi par différents éléments circonstanciés, les autorités publiques doivent mettre en œuvre les procédures d’évaluation du risque et d’adoption de mesures de précaution.
- Une opération s’inscrivant dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien d’ampleur présente un intérêt général dès lors qu’elle contribue à la politique énergétique, permet d’augmenter la part des énergies renouvelables et de diversifier les sources d’approvisionnement énergétique.
I. Eléments de rappel sur le principe de précaution
Le principe de précaution a été introduit en droit français à l’article L. 110-1 du code de l’environnement par la « loi Barnier » du 2 février 1995 (n° 95-101) :
» Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable. «
Ce principe de précaution a pleinement valeur constitutionnelle puisqu’il se trouve à l’article 5 de la Charte de l’environnement :
» Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. «
Trois conditions cumulatives sont nécessaires afin d’invoquer le principe de précaution :
– Il faut être en présence d’une incertitude scientifique pesant sur la réalisation d’un dommage ;
– Il faut démontrer la gravité du dommage ;
– Il faut démontrer l’irréversibilité du dommage.
II. La portée de la décision du Conseil d’Etat
Dans cette affaire, le Ministre chargé de l’énergie a, par arrêté du 28 mars 2017, déclaré d’utilité publique un ouvrage de transport d’électricité s’inscrivant dans le cadre d’un projet de parc éolien en mer situé au large de la commune de Saint-B. (Bretagne).
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Rennes, lequel a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis la requête au Conseil d’Etat, par ordonnance du 26 juin 2017.
En premier lieu, sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, le Conseil d’Etat rappelle qu’une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique.
La Haute juridiction revient ensuite sur ces exigences du principe de précaution.
De première part, il appartient à l’autorité compétente de l’Etat, saisie d’une demande tendant à ce qu’un projet soit déclaré d’utilité publique, de « rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé » qui justifieraient l’application du principe de précaution.
De deuxième part, si cette condition est remplie, il lui incombe de :
– Veiller à la mise en œuvre de procédures d’évaluation du risque identifié ;
– Vérifier, compte tenu de la plausibilité et de la gravité du risque ainsi que de l’intérêt de l’opération, que les mesures de précaution prises afin d’éviter la réalisation du dommage ne soient ni insuffisantes, ni excessives.
De troisième part, il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions à l’encontre d’une telle déclaration d’utilité publique, de :
– Vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée ;
– S’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre ;
– Vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
De dernière part, le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce, il existe un risque de leucémies infantiles » suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques » justifiant l’application du principe de précaution.
Cependant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution va être écarté au motif que les mesures prises par le porteur de projet » ne peuvent être regardées comme manifestement insuffisantes pour parer à la réalisation du risque allégué « .
En effet, il ressortait des pièces du dossier que le tracé retenu pour le projet correspond au » fuseau de moindre impact « , que » la liaison souterraine n’émet pas de champ électrique » en raison des précautions prises et qu’enfin, RTE est tenu de mettre en place un « dispositif pertinent de surveillance et de mesures des ondes électromagnétiques dans le cadre d’un plan de contrôle et de surveillance ».
Dès lors, le Conseil d’Etat valide le choix des mesures de précaution mises en place et juge que l’opération ne méconnait pas les exigences du principe de précaution.
En second lieu, sur l’utilité publique du projet, le Conseil d’Etat rappelle qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
De première part, la Haute juridiction relève qu’au cas d’espèce, le projet en cause s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien d’ampleur et contribue ainsi à la politique énergétique, en préservant » la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air […] « .
De deuxième part, le Conseil d’Etat précise que le projet a également vocation à » diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale « .
De dernière part, le Conseil d’Etat retient enfin que le projet déclaré d’utilité publique contribue, entre autres, à « l’objectif de porter la production d’énergies renouvelables en Bretagne à 3600 Mégawatts à l’horizon 2020, dont 100 Mégawatts d’éolien en mer « .
Dès lors, il est jugé que l’opération présente un intérêt général, en application des articles L. 100-1 4° et L. 100-2 3° du code de l’énergie.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d'Etat a confirmé que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté, ce 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. L'article 19 de ce projet de loi-cadre modifie plusieurs codes de manière à ce que l'Etat puisse, lors de la déclaration de projet (I) ou de la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)