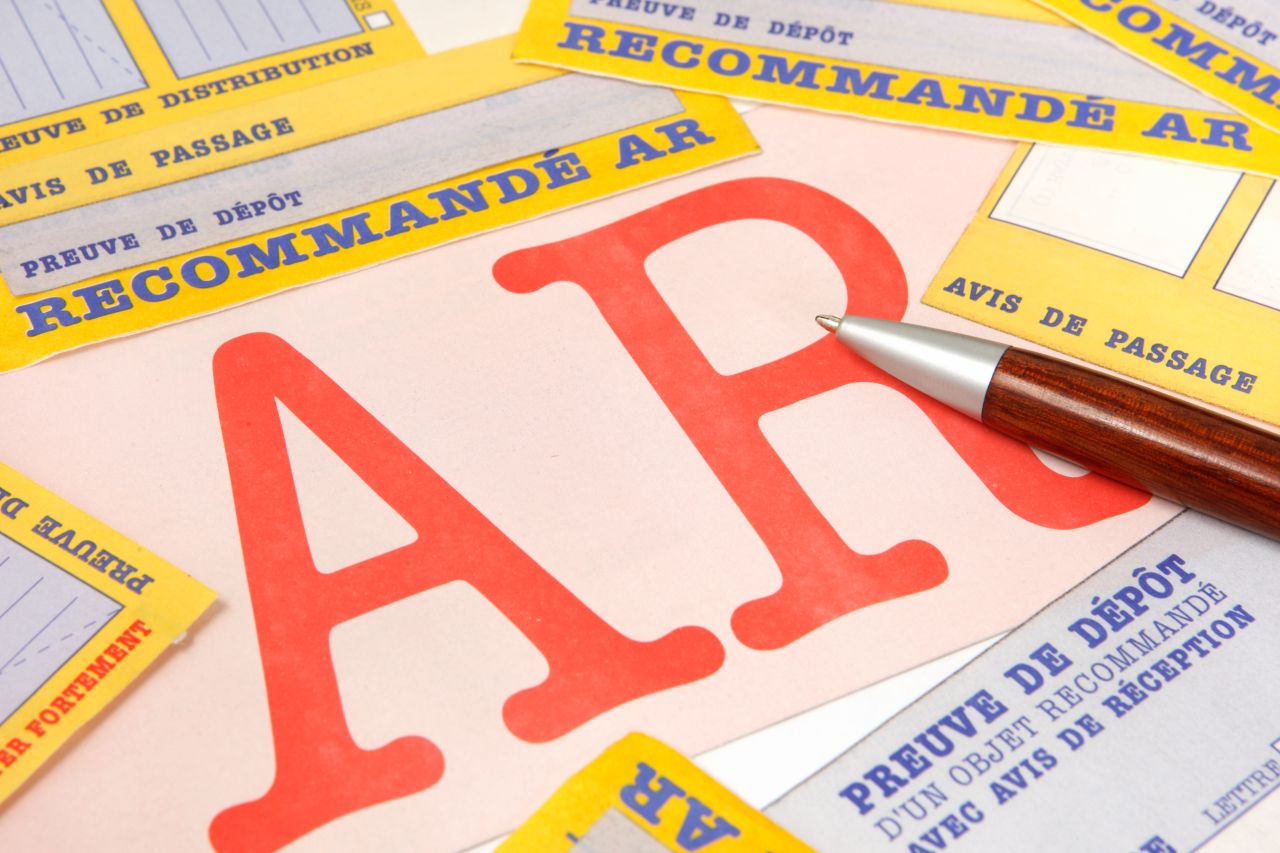En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Ecocide : une nouvelle proposition de loi est discutée à l’Assemblée nationale
Ce 27 novembre 2019, les députés membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale examineront la proposition de loi « portant reconnaissance du crime d’écocide » déposée par M Christophe Bouillon et plusieurs autres membres du groupe socialistes et apparentés. Analyse.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une précédente proposition de loi a déjà été au Parlement pour que soit organisées la définition et la sanction du crime d’écocide dans le code pénal
Le 19 mars 2019, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide a été déposée au Sénat par M Jérôme Durain et plusieurs autres membres du groupe socialiste et républicain Ce texte a été rejeté au Sénat, en commission puis en séance publique, le 2 mai 2019
Le rapport de la commission des lois du Sénat précise ainsi le motif du rejet du texte en commission en insistant sur l’imprécisions des termes retenus pour la définition du crime d’écocide :
« 1. Un texte juridiquement fragile
Pour votre commission, la définition proposée pour le crime d’écocide ne répond pas aux exigences constitutionnelles de précision et de clarté de la loi pénale. Le flou de cette définition exposerait le justiciable à un risque d’arbitraire d’autant plus inacceptable que les peines encourues sont lourdes. Votre rapporteur détaille dans le commentaire de l’article 1er les trop grandes imprécisions qui entachent ce texte.
Le texte est si flou qu’il paraît pouvoir englober des activités parfaitement légales, ou de grands projets d’infrastructures (la construction d’un barrage par exemple), qui sont susceptibles d’entraîner la dégradation d’un écosystème et de modifier en profondeur les conditions d’existence d’une communauté.«
Le 22 octobre 2019, une nouvelle proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide a été déposée à l’Assemblée nationale par M Christophe Bouillon et plus autres membres du groupe socialistes et apparentés. Ce texte sera examiné par la commission des lois le 27 novembre 2019.
La proposition de loi déposée par Christophe Bouillon est proche dans ses motifs et dans sa rédaction de celle déposée au Sénat par Jérôme Durain. Elle procède toutefois d’un effort manifeste de précision des termes juridiques employés.
I. Sur le crime d’écocide
La définition proposée du crime d’écocide
La proposition de loi du sénateur Jérôme Durain, rejetée au Sénat, proposait de définir le crime d’écocide de la manière suivante au sein du code pénal :
« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population. »
La proposition de loi du député Christophe Bouillon propose de définir le crime d’écocide de la manière suivante :
« Art. 413-15. – Constitue un écocide toute action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. »
Ces deux définitions présentent d’importantes différences.
En premier lieu, ces deux textes ne proposent pas d’inscrire le régime du crime d’écocide au même endroit dans le code pénal.
– la proposition de loi Durain prévoyait de créer un Livre II bis au sein du code pénal, intitulé « Des crimes contre l’environnement »
– la proposition de loi Bouillon prévoit, non pas de créer un nouveau livre mais d’inscrire le crime d’écocide au sein d’un nouveau chapitre III bis intitulé « De l’écocide » et inséré dans l’actuel Livre IV intitulé Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique »
En deuxième lieu, ces deux définitions diffèrent par leur contenu.
La proposition de Bouillon propose une définition plus précise mais aussi plus restrictive du crime d’écocide.
D’une part, l’action qui pourra être qualifiée d’écocide doit être « concertée et délibérée » alors que la proposition de loi Durain se bornait à exiger la preuve du caractère « concerté » de cette action. Plus encore, la proposition de loi Bouillon suppose que soit rapportée la preuve que les auteurs de l’écocide ait réalisé une action « commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ». La proposition de loi Bouillon insiste donc bien davantage sur la preuve de l’élément intentionnel de la faute. Démontrer, parfois des années après que les auteurs d’un crime avaient bien « connaissance des conséquences » de leur action et qu’ils ne pouvaient les ignorer sera sans doute plus délicat.
D’autre part, le dommage visé par la proposition de loi Bouillon est ainsi défini: « dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème ». Ainsi, seuls les dommages « étendus », irréversibles » et « irréparables » pourront être réparés au titre du crime d’écocide. S’agissant de dommages environnementaux souvent complexes et dont les effets peuvent être multiples et sur de longues périodes, la preuve de la réunion de ces critères pourra, là aussi s’avérer délicate. La proposition de loi Durain se bornait à faire état d’une « atteinte de façon grave et durable à l’environnement ».
Toutefois, la proposition de loi Durain imposait de prouver que le dommage ait été causé à l’environnement et aux personnes, là où la proposition de loi Bouillon ne fait état que des dommages à l’environnement.
S’agissant de la définition du terme « environnement », l’exposé des motifs de la proposition de loi du député Christophe Bouillon précise : « L’écosystème, déjà intégré dans la loi par l’article 1247 du code civil, renvoie à ce que les biologistes définissent comme la combinaison dynamique entre un environnement naturel (biotope) et les êtres vivants qui l’habitent. »
Enfin, la proposition de loi Bouillon insiste sur le lien de causalité entre la faute et le dommage : « tendant à causer directement« . Un lien indirect ne pourra donc pas donner lieu à condamnation.
En définitive, il faut vraiment que plusieurs personnes aient agi dans l’intention claire et démontrée de détruire l’environnement de manière particulièrement grave pour que le crime d’écocide soit réalisé. C’est en réalité un véritable plan qui devra être démontré.
La sanction proposée du crime d’écocide
La proposition de loi du sénateur Jérôme Durain prévoyait la sanction suivante :
« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende ».
La proposition de loi du député Christophe Bouillon prévoit la sanction suivante :
« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent »
La proposition de loi Bouillon prévoit donc une amende plus élevée et un cas nouveau : celui du crime d’écocide commis par une entreprise.
II. Sur le crime de provocation à commettre un écocide
Les deux propositions de lois sanctionnent la provocation à commettre un crime d’écocide.
La proposition de loi du sénateur Jérôme Durain la définit ainsi :
« Art. 230-2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.
« Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.«
La proposition de loi du député Christophe Bouillon précise pour sa part :
« Art. 413-16. – La provocation publique et directe, par tous les moyens, à commettre un écocide est punie de sept ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet.
« Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.«
On notera que la sanction de la provocation, suivie ou non d’effet, est moindre dans la rédaction de la proposition de loi du député Christophe Bouillon.
III. Sur la contribution au crime d’écocide
La proposition de loi du sénateur Jérôme Durain précisait :
« Art. 230-3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende. »
La proposition de loi du député Christophe Bouillon précise pour sa part :
« Art. 413-17. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définies aux articles 413-15 est punie de vingt ans de réclusions criminelle et de 10 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ».
Les deux propositions de lois diffèrent donc sur le montant de l’amende et sur la sanction spécifique relative au chiffre d’affaires d’une entreprise.
En conclusion, même si elle était adoptée, la proposition de loi du député Christophe Bouillon devrait avoir une portée assez réduite sinon symbolique.
A l’actif de cette proposition de loi figure sans aucune doute d’être plus précis et de mieux encadrer le crime d’écocide. Egalement, il est exact que le droit n’appréhende pas pour l’heure de manière spécifique la particularité de crimes environnementaux à grande échelle.
Toutefois, ce texte appelle aussi les observations suivantes.
En premier lieu, il n’est pas certain que le crime d’écocide soit une bonne réponse à une bonne question.
Les dommages environnementaux à grande échelle se caractérisent souvent par la pluralité des facteurs et la complexité des conséquences d’actions et de décisions souvent nombreuses. La pollution de l’air, la pollution par les produits phytosanitaires ou bien encore les déchets sont rarement l’oeuvre d’un groupe de personnes bien identifiées produisant de manière concertée et délibérée sur une période déterminée des conséquences aisément expertisables et quantifiables mais plutôt sur de longues durées. En d’autres termes, l’écocide est, pour l’heure une réponse simple à une question complexe. En outre, les mécanismes des dommages environnementaux ne sont en rien comparables à ceux des génocides ni sur le plan matériel, ni sur le plan juridique. Pourtant, l’écocide procède bien d’une réflexion sur le génocide comme les deux propositions de lois ici étudiées le rappellent.
En deuxième lieu, la preuve de tous les éléments de la faute, du dommage et du lien de causalité sera sans doute assez complexe à rapporter. Et bien d’autres questions de procédure restent à régler comme celles de l’identification des personnes recevables à agir pour demander réparation de l’écocide.
En troisième lieu, il faut s’interroger sur les moyens humains et matériels de la justice pénale. Le droit pénal de l’environnement pénal existant est d’application encore trop rare et la priorité est sans doute de donner les moyens aux juges de poursuivre les infractions d’ores et déjà définies avant d’en créer de nouvelles.
Enfin, il serait certainement plus pertinent de poursuivre la réflexion en cours sur l’utilité d’inscrire le crime d’écocide en droit international car ce crime a sans doute pour caractéristique de produire des conséquences qui ne peuvent se borner aux frontières d’un Etat.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi mais le risque d’un « moratoire light » sur les énergies renouvelables demeure
Ce mardi 24 juin 2025, les députés doivent se prononcer, lors du vote solennel, pour ou contre la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si le texte est rejeté par...
économies d’énergie : le point sur les dernières évolutions réglementaires relatives aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’
Les dispositifs des certificats d’économies d’énergie (CEE) et de MaPrimeRénov’ ont connu des modifications importantes avec la récente publication de plusieurs textes au Journal officiel, en sus des annonces du Gouvernement relatives à la suspension d’une partie du...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.