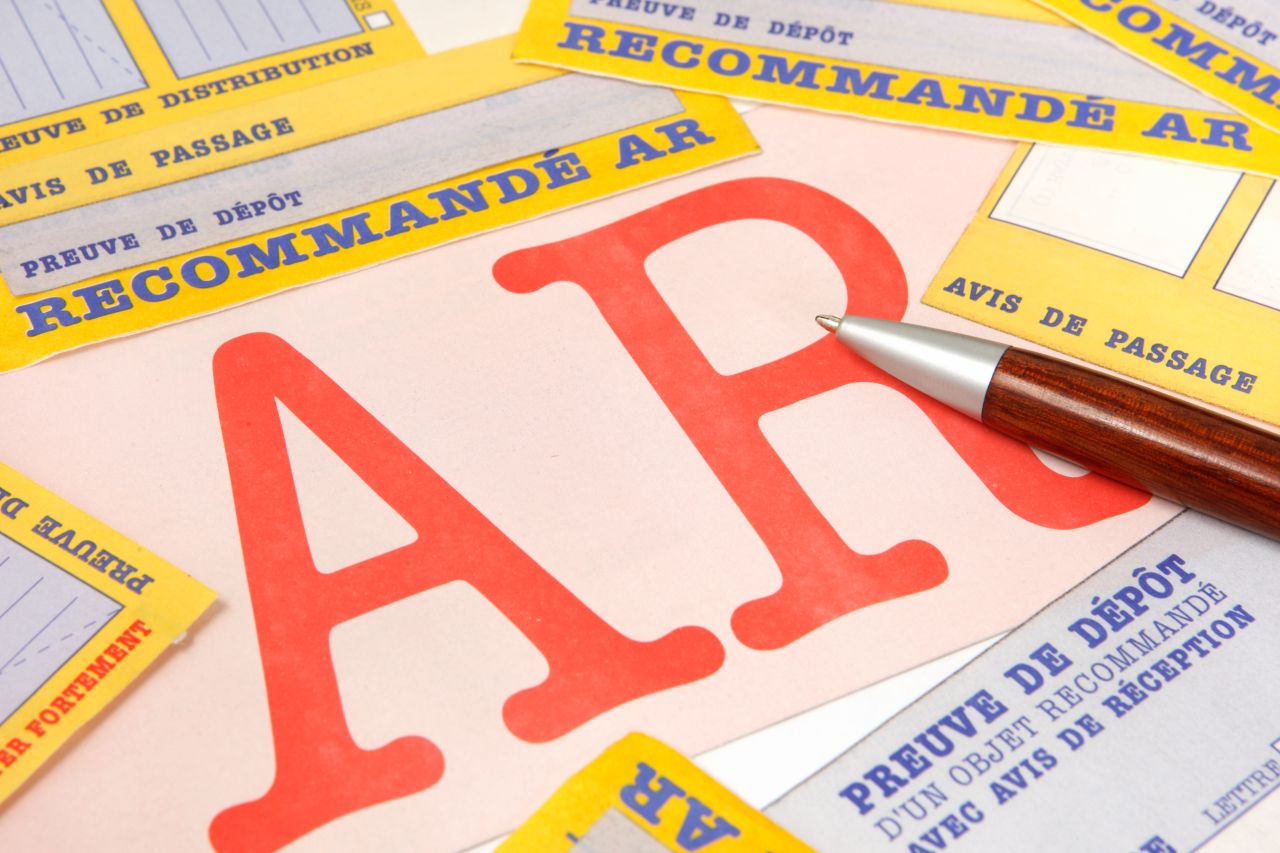En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Le principe de précaution : un enjeu de la campagne présidentielle
Si l’environnement ou la transition énergétique ne sont pas toujours au cœur des propos des candidats à l’élection présidentielle, leurs programmes comportent généralement des développements sur ces sujets. Et, de manière intéressante, le principe de précaution y occupe une place importante, qu’il s’agisse de proposer sa suppression ou sa conservation. Analyse par Arnaud Gossement, auteur d’une thèse de doctorat sur ce principe.
Depuis vingt ans, le principe de précaution – qui est d’abord un principe directeur du droit de l’environnement – n’a pas cessé d’être un sujet de controverse au cœur de nombreux débats politiques. Malheureusement, aussi souvent cité que rarement appliqué, le principe de précaution n’occupe tant de place dans le débat politique que parce que son sens et sa portée sont souvent méconnus. Et cette passion du principe de précaution est paradoxale car ce dernier ne s’applique que dans des situations fort rares. Le juge en sanctionne la méconnaissance tout aussi rarement. Le principe de précaution n’est donc fréquemment invoqué que parce qu’il n’est que rarement lu.
Juridiquement, demander la suppression du principe de précaution n’a pas grand sens, sauf à oublier que notre droit de l’environnement est d’abord international et européen. Politiquement, cela permet de séduire certains électeurs qui peuvent penser que la protection de l’environnement constituerait une menace pour leur mode de vie ou leur activité professionnelle.
Pourtant, le principe de précaution ne mérite ni excès d’honneur ni indignité. Le procès qui lui est fait doit cependant retenir l’attention car il peut affecter le droit de l’environnement en général, ce à quoi il convient d’être vigilant.
Le principe de précaution : un principe d’action
Pour analyser l’intérêt sinon la passion que suscite le principe de précaution, il convient d’en rappeler, au moins brièvement, l’origine et le sens. Dans sa forme actuelle, le principe de précaution a accédé à la notoriété lorsqu’il a été inscrit dans la Déclaration finale du sommet de la Terre de Rio du 14 juin 1992. Il a ensuite été introduit en droit communautaire par le traité de l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992. Il a été intégré en droit français à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, issu de la loi n°95-101 du 2 février 1995. Surtout, le principe de précaution est inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005. C’est, sans aucun doute, le principe le plus connu de ladite Charte et pourtant pas le plus appliqué. En voici la définition :
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
Que lit-on ? Que le principe de précaution est l’inverse d’un principe d’inaction. Il impose en effet aux « autorités publiques » : d’une part d’encourager la recherche scientifique (« mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques »), d’autre part d’agir (« adoption de mesures provisoires et proportionnées »). Il suffit de lire l’article 5 de la Charte de l’environnement pour s’assurer que le principe de précaution n’empêche pas le progrès scientifique mais le commande, ne décourage pas la prise de risques mais l’accompagne. Aucune définition du principe de précaution ne précise qu’il peut servir de motif à ne rien faire. Et pour cause : le principe de précaution a précisément été créé en réponse à des scandales sanitaires et environnementaux liés à une carence des décideurs publics, à une absence de prise de décision publique rapide.
Un principe à destination des autorités publiques
Contrairement à une crainte entretenue, le principe de précaution n’est pas une nouvelle cause d’engagement de responsabilité civile ou pénale des personnes privées. Le principe de précaution n’a nullement vocation à paralyser l’activité des entreprises ou des citoyens. Tel qu’inscrit en droit européen, dans notre Constitution ou dans notre code de l’environnement, il ne vise que les autorités publiques qui sont tenues d’agir, même en situation d’incertitude scientifique.
C’est pourquoi il convient d’étudier la jurisprudence administrative pour savoir de quelle manière ce principe est reçu par le juge. La décision sans doute la plus célèbre est celle par laquelle le Conseil d’Etat, sur le fondement du principe de précaution, a prononcé le sursis à exécution d’un arrêté du ministre de l’agriculture qui avait pour objet l’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, de trois variétés de maïs transgénique (cf. CE, 25 septembre 1998, Greenpeace France, n° 194348). Souvent invoqué par les requérants, le juge peut en admettre l’invocabilité de ce principe tout en écartant sa violation : il en allé ainsi pour les champs électromagnétiques des antennes-relais ou les lignes à très haute tension. A front renversé, une société portant un projet d’exploration d’hydrocarbures non conventionnels a récemment tenté devant le Conseil constitutionnel de se prévaloir d’une mauvaise application du principe de précaution par le législateur pour obtenir, en vain, que la loi du 13 juillet 2011, portant interdiction de la technique de fracturation hydraulique, soit déclarée contraire à la Constitution (cf. Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013).
Le principe de précaution au cœur de nombreux débats parlementaires
Depuis vingt ans, le principe de précaution a fait l’objet d’une multitude de tentatives tendant à l’effacer de notre droit. La stratégie des parlementaires opposés au principe de précaution consiste, soit à en proposer la suppression, soit à en restreindre l’application, soit à le renommer en principe d’innovation. Parmi les exemples les plus récents :
Le 1er février 2012, l’Assemblée nationale a voté une résolution « sur la mise en œuvre du principe de précaution » qui propose de subordonner le principe de précaution au respect de plusieurs conditions pour en limiter l’application.
Le 10 juillet 2013, les députés Éric Woerth et Damien Abad ont déposé une proposition de loi constitutionnelle n° 1242 visant à ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle en le supprimant de la Charte de l’environnement.
Le 26 novembre 2013, le député Damien Abad a déposé une proposition de loi constitutionnelle n°1580 visant à équilibrer le principe de précaution avec le principe d’innovation.
En mai 2014, les sénateurs ont voté une proposition de loi constitutionnelle n° 1975 visant à modifier la Charte de l’environnement pour préciser que le principe de précaution est un principe d’innovation.
Le 14 octobre 2014, les députés Éric Woerth, Damien Abad et Bernard Accoyer ont déposé une proposition de loi constitutionnelle n° 2293 tendant à remplacer le principe de précaution par un « principe d’innovation responsable ».
Toutes ces tentatives ont échoué mais leur répétition témoigne de ce que le principe de précaution est un sujet de controverse permanente. Controverse qui prend place dans le débat politique qui précède l’élection présidentielle de 2017.
Remettre le principe de précaution à sa place
Le principe de précaution est un principe directeur du droit de l’environnement. Ce qui signifie qu’il a vocation à guider, à orienter l’élaboration des normes qui composent le droit de l’environnement.
Remettre en cause ce principe directeur revient aussi à remettre en cause le droit de l’environnement dans sa structuration actuelle. Les responsables politiques qui se positionnent contre le principe de précaution se positionnent aussi et surtout contre l’importance grandissante du droit de l’environnement. Voire tout simplement contre la place que la protection de l’environnement peut occuper dans le débat public.
Le principe de précaution est, en réalité, le prétexte et la victime d’un rejet de l’écologie politique. Il faut cependant reconnaître que certains défenseurs du principe de précaution le fragilisent aussi en l’invoquant trop fréquemment, pour des situations où il ne s’applique pas, voire en en le brandissant pour exiger moratoires et interdictions de construire.
Il est donc temps de remettre le principe de précaution à sa place, en analysant attentivement son contenu. Le principe de précaution gagnerait à redevenir un principe juridique et ne plus être un slogan ou un objet de passion politique.
Arnaud Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi mais le risque d’un « moratoire light » sur les énergies renouvelables demeure
Ce mardi 24 juin 2025, les députés doivent se prononcer, lors du vote solennel, pour ou contre la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si le texte est rejeté par...
économies d’énergie : le point sur les dernières évolutions réglementaires relatives aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’
Les dispositifs des certificats d’économies d’énergie (CEE) et de MaPrimeRénov’ ont connu des modifications importantes avec la récente publication de plusieurs textes au Journal officiel, en sus des annonces du Gouvernement relatives à la suspension d’une partie du...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.