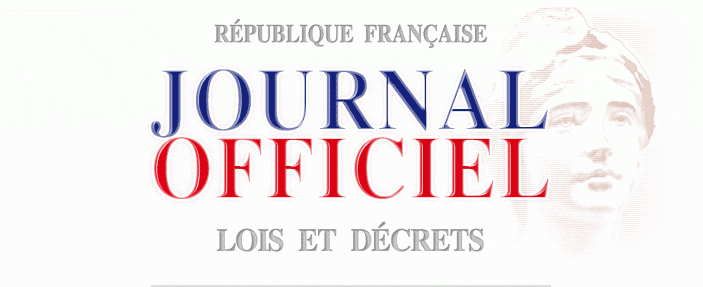En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution – et plus précisément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme – le 4 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 26 de la loi déférée, lequel complétait l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme afin de déterminer les conditions de recevabilité d’un recours formé contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution. Aux termes d’une décision d’une rédaction très prudente, le Conseil constitutionnel a estimé que la limitation disproportionnée du droit à un recours effectif est contraire à la Constitution. Commentaire.
Résumé
1. Le 15 octobre 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
2. L’article 26 de cette loi comportait une série de mesures pour accélérer le traitement des recours contre les documents et projets d’urbanisme devant le juge administratif. Le 4 ° du paragraphe I et le paragraphe II de cet article 26 complétaient l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme afin de déterminer les conditions de recevabilité d’un recours formé contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution.
3. Ces dispositions avaient pour objet principal de réduire le nombre de recours en interdisant à une personne de contester un document d’urbanisme (PLU…) devant le juge administratif à défaut d’avoir participé à la consultation du public préalable à son adoption
4. Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et plus précisément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.
I. Rappel : la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement
Pour mémoire, ce 15 octobre 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Cette loi a notamment pour objet de réduire le risque de refus d’autorisation d’urbanisme par l’administration ou d’annulation d’une autorisation d’urbanisme par le juge administratif. Ce texte :
- accroit la possibilité de contester la légalité d’un document d’urbanisme en abrogeant l’article L.600-1 du code de l’urbanisme relatif à la contestation des documents d’urbanisme par voie d’exception.
- réduit le droit au recours contre les documents d’urbanisme en imposant une nouvelle condition de recevabilité relative à la participation du public (modification de la rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme).
- réduit le risque de décisions de refus d’autorisation d’urbanisme (modification de la rédaction de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme).
- tente de faciliter la suspension en référé des refus d’autorisation d’urbanisme en dispensant de la preuve de l’urgence l’auteur du recours (nouvel article L.600-3-1 du code de l’urbanisme).
- réduit le délai de recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme en prévoyant que l’exercice d’un recours gracieux n’a plus pour effet de le proroger (nouvel article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme).
Cette loi a été déférée à la censure du Conseil constitutionnel par plusieurs parlementaires.
II. Le résumé de la décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025 du Conseil constitutionnel
Par une décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré certaines à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
Dans le détail, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement :
- L’article 5 créait un identifiant unique attribué à chaque bâtiment, enregistré dans un référentiel national des bâtiments (cavalier législatif)
- L’article 6 prévoyait la transmission par l’administration fiscale, à certains services de l’État et organismes, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une liste de locaux recensés à des fins de gestion de la taxe d’habitation et des taxes sur les logements vacants (cavalier législatif).
- L’article 10 instaurait une dérogation à l’interdiction de construction en dehors des espaces proches du rivage, dans certaines communes, pour les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières (cavalier législatif).
- L’article 11 supprimait l’obligation de réaliser une étude d’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale (cavalier législatif).
- L’article 12 visait à soumettre les changements de sous-destinations réglementées par le plan local d’urbanisme à déclaration préalable (cavalier législatif).
- L’article 13 modifiait le contenu des conventions d’utilité sociale et leurs modalités de conclusion entre le représentant de l’État dans le département, les organismes d’habitations à loyer modéré et les collectivités territoriales auxquelles ils se rattachent (cavalier législatif).
- L’article 14 permettait aux offices publics de l’habitat d’inclure des locaux commerciaux dans leurs projets immobiliers (cavalier législatif).
- L’article 16 supprimait une possibilité de déroger à certaines règles de construction en matière de surélévation de bâtiments pour la réalisation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (cavalier législatif).
- Le 4 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 26 de la loi déférée, lequel complète l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme afin de déterminer les conditions de recevabilité d’un recours formé contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution.
- L’article 27 visait à autoriser certains échanges d’informations entre l’administration fiscale et les bailleurs sociaux sur la situation de leurs locataires et prévoit les modalités de mise à disposition de données publiques à des fins de recherche scientifique ou historique (cavalier législatif).
- L’article 28 supprimait l’autorisation du représentant de l’État dans le département pour la vente à une personne privée, par un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte, de logements faisant partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux (cavalier législatif).
- L’article 30 réduisait de trente à quinze ans le délai au terme duquel les immeubles faisant partie d’une succession peuvent être considérés comme des biens sans maître dont la propriété est susceptible d’être transférée de plein droit à une commune et précise à cet égard l’application des règles de droit civil relatives à la prescription (cavalier législatif).
- L’article 31 autorisait la transmission d’informations détenues par l’administration fiscale au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour la mise en œuvre de la procédure d’acquisition d’immeubles considérés comme des biens sans maître (cavalier législatif).
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- Le premier alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi déférée qui prévoit le principe d’une cristallisation, à la date de délivrance du permis de construire initial, des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis modificatif, sous la seule réserve des règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
- Le 3 ° du paragraphe I de l’article 26 de la loi déférée, lequel abroge l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme relatif aux conditions dans lesquelles l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de certains documents d’urbanisme peut être invoquée par voie d’exception.
- L’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi déférée, lequel réduit le délai dans lequel un recours administratif peut être formé à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme, et de prévoir que l’exercice d’un tel recours ne proroge pas le délai de recours contentieux contre cette décision.
III. La limitation disproportionnée du droit au recours effectif est contraire à la Constitution
La décision rendue ce 20 novembre 2025 retient particulièrement l’attention sur le point suivant : le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 4 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 26 de la loi déférée, lequel complétait l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme afin de déterminer les conditions de recevabilité d’un recours formé contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution.
Plus précisément, l’article 26 de la loi ici commentée ajoutait un alinéa à cet article L.600-1-1 du code de l’urbanisme de manière à créer une nouvelle condition de recevabilité des recours contre les décisions d’approbation des documents d’urbanisme (SCOT, PLU etc..). Une personne « autre que l’État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements » devait désormais démontrer qu’elle « pris part à la participation du public » avant de déposer un recours :
« Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée avant cette décision contestée. » ;
Il convient de souligner que cette disposition procède d’un amendement déposé par le sénateur Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la Commission des lois du Sénat, en première lecture. L’exposé des motifs de cet amendement précisait notamment : « Il n’apparaît pas justifié, aux yeux du rapporteur, qu’en dépit des efforts de concertation déployés par la collectivité, un requérant qui n’aurait pas participé aux discussions préalables puisse après l’adoption du document le remettre en cause, alors qu’il n’est plus possible pour la commune ou l’établissement de tenir compte d’observations qui aurait pu permettre d’éviter l’engagement d’un contentieux et, parfois, l’annulation du document. »
Il est intéressant de relever que lors des débats en commission sur cet amendement, son risque d’inconstitutionnalité avait déjà été pointé par la sénatrice Audrey Linkenheld : « Nous sommes dubitatifs quant à cet amendement, vraisemblablement inconstitutionnel. Contrôler la participation effective d’un requérant à la consultation, tant en présentiel qu’en distanciel, nous semble très délicat. »
Malgré cette alerte, l’amendement a été conservé dans la version définitive de la loi telle qu’adoptée par les deux assemblées puis soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
A. Le fondement de la déclaration d’inconstitutionnalité : l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme
En premier lieu, le Conseil constitutionnel s’est fondé, exclusivement, sur les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, lequel protège le droit au recours effectif devant une juridiction :
« 23. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.«
De manière assez étrange, le Gouvernement s’est fondé sur l’article 7 de la Charte de l’environnement pour tenter de justifier ce détournement de la procédure de participation du public.
Il est, à notre sens, regrettable que le Conseil constitutionnel n’ait pas – aussi – déclaré ces dispositions limitant le droit à un recours effectif sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement consacrant le principe de participation du public. Cela aurait permis, précisément, de lui donne un contenu tel qu’il ne puisse pas être instrumentalisé au service d’une œuvre de régression d’autres droits comme, ici, le droit à un recours effectif.
B. La limitation du droit au recours effectif peut être d’intérêt général
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a pris soin de souligner que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en prenant une mesure de limitation du droit à un recours effectif dans le but de « limiter les risques d’incertitude juridique qui pèsent sur ces documents d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires ».
« 24. Les dispositions contestées prévoient qu’une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public organisée avant cette décision.
25. Il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter les risques d’incertitude juridique qui pèsent sur ces documents d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.«
Ces précisions sont assez discutables.
- D’une part, il est un peu rapide de soutenir de manière aussi tranchée que la limitation du droit à un recours effectif pourrait contribuer à « limiter les risques d’incertitude juridique qui pèsent sur ces documents d’urbanisme » et « prévenir les recours abusifs et dilatoires« . Le Conseil constitutionnel ne donne ici aucun élément de preuve du bien fondé de cette affirmation. Il aurait été utile qu’il fasse état de données statistiques vérifiables. Il aurait également pu donner sa définition du « recours abusif et dilatoire« .
- D’autre part, il pourrait tout à fait être soutenu en sens contraire que ces vraies fausses mesures de simplification du droit contribuent en réalité à sa complexification et à son instabilité. Elles ne réduisent en rien le « risque de recours » que le législateur prétend ainsi combattre depuis 2006. Si une catégorie de recours ne peut plus être exercée, une autre le sera, même limitée.
- Enfin, sur un plan plus politique, il peut être soutenu que ces vraies-fausses mesures de simplification sont des mauvaises réponses à de bonnes questions. Si la souffrance du secteur de la construction est un fait, rien ne prouve que cette tentative de limitation des recours contre le documents d’urbanisme soit une réponse adaptée.
C. La limitation du droit au recours doit être proportionnée
En troisième lieu, si le législateur peut donc restreindre le droit à un recours effectif, il doit le faire de manière proportionnée. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La première raison tient au champ d’application très vaste ce que cette mesure qui concernait un grand nombre de personnes – tous les requérants à l’exception de l’Etat et des collectivités territoriales – et un grand nombre de décisions administratives :
« 26. Toutefois, d’une part, la limitation du droit au recours résultant des dispositions contestées concerne l’intérêt pour agir de toute personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et s’applique à l’ensemble des décisions d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution, qui sont des actes réglementaires. »
La deuxième raison de cette disproportion tient à sa portée à la fois imprécise et trop importante. Aux termes de la disposition censurée, une personne aurait pu être irrecevable à agir devant le juge administratif alors même qu’elle pouvait ne pas avoir connaissance de l’illégalité de la décision à venir, lors de la consultation du public :
« 27. D’autre part, en subordonnant la recevabilité du recours contre une telle décision à la condition de prendre part à la participation du public organisée préalablement, ces dispositions, dont la portée est au demeurant imprécise, privent la personne de la possibilité de former un recours direct même lorsqu’elle n’a pas pu avoir connaissance, au stade de la consultation du public, de l’illégalité éventuelle de cette décision, y compris lorsque cette illégalité résulte de modifications ou de circonstances postérieures à la clôture de la procédure de participation du public. »
Cette mesure, si elle avait été appliquée, aurait confiné à l’absurde. Toute personne aurait été encouragée, par précaution, à se constituer la preuve d’une participation à la consultation du public sur un projet de document d’urbanisme avant même de savoir si ce dernier lui apparaît contestable. Une preuve au surplus difficile à rapporter car la loi n’aurait pas précisé comment l’administrer…
Enfin, le Conseil constitutionnel a pris soin de souligner que cette interdiction d’accès au juge administratif n’aurait pas pu être « compensée » par le droit d’exercer un autre recours. Ainsi, le recours contre un refus d’abroger le document d’urbanisme en cause ne permet plus « ni d’invoquer certains vices de légalité externe, ni d’obtenir l’annulation rétroactive de la décision » :
« 28. En outre, la possibilité ouverte à toute personne de contester la légalité de cette décision, soit par voie d’exception, soit à l’occasion d’un recours contre le refus de l’abroger, ne permet, en application du régime contentieux de droit commun rendu applicable par le 4 ° du paragraphe I de l’article 26 de la loi déférée, ni d’invoquer certains vices de légalité externe, ni d’obtenir l’annulation rétroactive de la décision. »
Le 4 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 26 de la loi déférée sont donc déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Mais le mal persiste : loi de simplification après loi de simplification, le législateur ne cesse d’accréditer l’idée que les difficultés d’ordre économique d’un secteur peuvent être traitées au moyen juridique d’une limitation du droit au recours au juge. Pendant ce temps les causes premières desdites difficultés demeurent entières. Quant aux recours, c’est sans doute davantage en donnant des moyens humains et matériels conséquents aux juridictions qu’il sera possible d’accélérer le traitement du contentieux.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique
La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation. Résumé Selon...
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
Le 1er janvier 2026, a été publié au Journal officiel, le décret relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Pour rappel, le mécanisme de capacité a été créé pour garantir le maintien en fonctionnement de capacités...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
L’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2025. Cet arrêté complète le cadre réglementaire de la sixième...
Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)
Par deux décisions rendues ce 22 décembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions relatives à la procédure d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En premier lieu, la Haute juridiction administrative a jugé que...
Dérogation espèces protégées : le préfet doit mettre en demeure, à tout moment, l’exploitant d’une ICPE de régulariser sa situation (CE, 16 décembre 2025, n°494931)
Par une décision n°494931 rendue ce 16 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que le préfet doit mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée (ici un parc éolien) de déposer une demande de dérogation espèces protégées lorsque les conditions sont réunies....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.