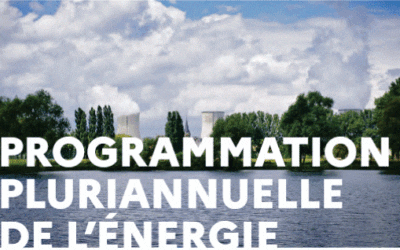En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Droit de dérogation des préfets : publication du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020
Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet a été publié au journal officiel du 9 avril 2020. Analyse.
Résumé
- Par un décret n°2020-412 du 8 avril 2020 publié au JO du 9 avril 2020, le Gouvernement a pérennisé le droit pour les préfets de déroger, à certaines conditions, à des normes nationales, dans un souci de simplification du droit
- Ce décret n°2020-412 du 8 avril 2020 intervient au terme d’une expérimentation de deux ans et demi ouverte à la suite de la publication décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet
- Par une décision du 17 juin 2019 (n° 421871), le Conseil d’Etat avait rejeté le recours en annulation du décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet, au motif que celui-ci ne méconnaît pas le principe de non-régression.
Les conditions d’exercice du droit de dérogation préfectoral
Le préfet ne peut exercer son pouvoir de dérogation que dans le respect des conditions cumulatives suivantes, définies aux articles 1 à 3 du décret n°2020-412 du 8 avril 2020 :
– le préfet ne peut déroger qu’à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat : en aucun cas, il ne peut déroger à d’autres normes : lois, Constitution ou dispositions du droit de l’Union européenne par exemple.
– le préfet ne peut prendre que des décisions non réglementaires. Le préfet ne pourra ainsi que répondre à des demandes individuelles et prendre des décisions qui n’auront pas de valeur réglementaire c’est à dire générale
– le préfet ne peut agir que dans le respect de sa compétence : il ne peut pas prendre de décision qui relèverait par exemple, de la compétence des collectivités territoriales.
– le préfet ne peut agir que dans certaines matières (cf. ci-dessous)
– la décision de déroger doit être justifiée par un un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
– la décision de déroger doit avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ;
– la décision de déroger doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
– la décision de déroger ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;
– La décision de déroger prend la forme d’un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (article 3)
A noter : la décision de déroger peut, soit prendre la forme d’un arrêté préfectoral comportant cette seule décision, soit être insérée dans un arrêté préfectoral pris au terme d’une procédure régulière. La note du Premier ministre du 9 avril 2018 relative au décret du 29 décembre 2017 précisait en effet : « La décision de dérogation peut faire l’objet d’un arrêté spécifique, mais il est également possible qu’il en soit fait mention au sein de la décision prise au terme de la procédure réglementaire appliquée. Ces deux options dépendent des conditions dans lesquelles la dérogation intervient« .
Les conditions auxquelles une décision de dérogation doit satisfaire sont donc assez nombreuses et leur respect sera contrôlé par le juge administratif. Le pouvoir de dérogation préfectoral est donc nécessairement assez réduit. On retiendra principalement que l’objectif de simplification du droit est principalement réalisé au travers de la dispense d’obligation pour le préfet de procéder à des consultations préalables ou d’organiser une participation du public.
Les matières ouvertes au droit de dérogation préfectoral
Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-412 du 8 avril 2020, les matières ouvertes à l’exercice du pouvoir de dérogation préfectoral sont les suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
La liste des matières dans lesquelles le préfet peut exercer son pouvoir de dérogation est identique à celle établie par le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 est identique à celle qui avait été initialement définie par le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017
Un décret pris à la suite d’une expérimentation engagée en 2017
Le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 intervient à la suite d’une expérimentation engagée à la suite de la publication du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet.
Le but de ce décret était de permettre aux préfets de tenir compte de circonstances locales autrement qu’en ayant recours à une ‘interprétation facilitatrice » qui ne permet pas d’assurer la sécurité juridique des décisions et autorisations individuelles ainsi prises.
Pour mémoire, le décret du 29 décembre 2017 avait autorisé à titre expérimental et pendant une durée de deux ans certains préfet à déroger déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat. Il s’agissait des préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (article 1er du décret).
Selon le ministère de l’intérieur :
« En deux ans et demi d’expérimentation, 183 arrêtés dérogatoires ont été pris.
Par exemple, le 31 mai 2018, le préfet de l’Yonne a autorisé l’installation d’une usine de méthanisation utile pour un territoire dans une zone bleue (construction limitée) qui allait être déclassée pour devenir constructible.
Autre exemple, le 16 août 2018, le préfet de la Mayenne a pu alléger les procédures administratives à réaliser par une commune pour installer des préfabriqués permettant d’accueillir à la rentrée de septembre 2019 des classes d’une école élémentaire qui avait été sinistrée par des inondations en juin 2018. »
A noter : ce décret n°2020-412 du 8 avril 2020 n’a pas été pris sur le fondement des normes récemment adoptées sur le fondement de la police spéciale de l’urgence sanitaire (code de la santé publique).
Le droit de dérogation préfectoral ne méconnaît pas le principe de non régression
Par une décision du 17 juin 2019 (n° 421871), le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation du décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet.
Le Conseil d’Etat a jugé que ce décret ne méconnaît pas le principe de non-régression tel qu’inscrit à l’article L.110-1 du code de l’environnement : « Si l’association requérante soutient que les dispositions du décret attaqué méconnaissent ce principe, il résulte des ses termes mêmes et notamment de son article 1er qu’il ne permet pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi tel que le principe de non-régression. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté« .
Arnaud Gossement
Avocat associé – cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d'Etat a confirmé que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté, ce 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. L'article 19 de ce projet de loi-cadre modifie plusieurs codes de manière à ce que l'Etat puisse, lors de la déclaration de projet (I) ou de la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)