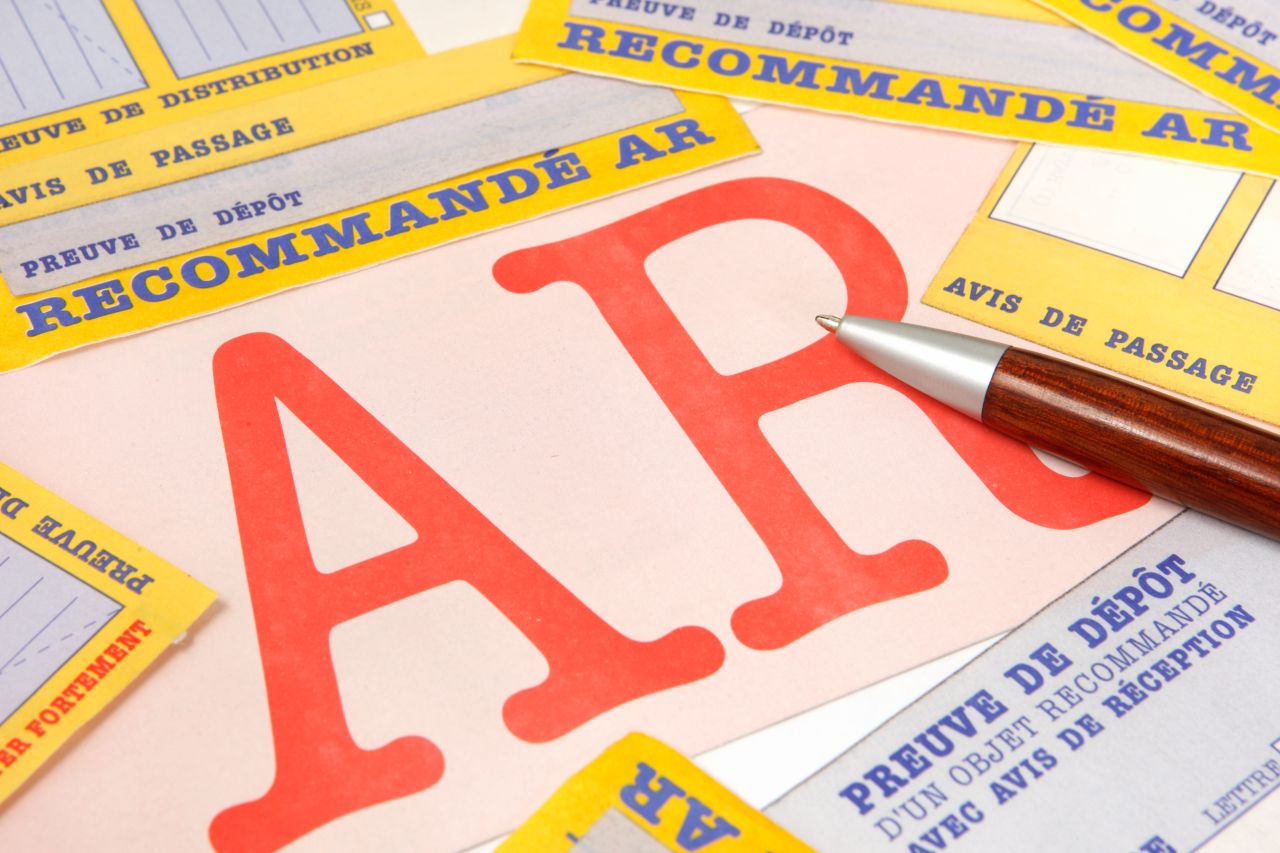En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
2025 : vingtième anniversaire de la Charte de l’environnement
Le 1er mars 2025, nous fêterons le vingtième anniversaire de la Charte de l’environnement. Et plus précisément, de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. Pour la première fois dans son histoire, la France a ainsi consacré, dans son contrat social, au plus haut niveau de son Droit, le droit à un environnement sain et équilibré et le devoir de le préserver. L’occasion de rappeler quelques dates de l’histoire de ce texte fondamental qui a contribué à diffuser la question écologique dans toutes les branches de notre droit et dans notre société.
Introduction
Une étape importante de l’histoire du droit de l’environnement. La Charte de l’environnement représente une étape importante de l’histoire du droit de l’environnement. De 1976 à 2005, ce droit s’est structuré de manière à devenir progressivement une branche du Droit, dotée d’objectifs propres (protection de l’environnement, développement durable..) et de principes généraux (prévention, précaution, pollueur-payeur..) qui ont permis à cet ensemble de règle d’accroître sa cohérence et son autonomie. Le droit de l’environnement est ainsi passé d’un « droit d’ingénieur » constitué de règles techniques éclatée en plusieurs législations et codes à un droit structuré dont les projets de normes peuvent désormais être évalués à l’aune de principes généraux qui ont, tous, valeur constitutionnelle.
Pour mémoire, l’année 1976 a été marquée par le vote de deux grandes lois. La première est la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Son article premier comporte une esquisse de définition du périmètre du droit de l’environnement et de ses premiers objectifs. Le texte comporte en outre des dispositions importantes sur l’évaluation environnementale, le régime des protection des espèces animales et végétales ou bien encore les réserves naturelles. La deuxième est la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Laquelle a créé un régime d’autorisation et de contrôle des activités industrielles qui servira sans doute de matrice aux autres polices administratives spéciales qui composent désormais le code de l’environnement.
D’une branche à une racine du droit. Depuis 2005, pour prendre une image, le droit de l’environnement est devenu une racine de notre Droit alors qu’il en était une branche. Sa constitutionnalisation grâce à la promulgation de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement a produit plusieurs effets. En premier lieu, elle a permis de constitutionnaliser la protection de l’environnement et son droit. Certes, le droit international et européen comportait déjà nombre d’objectifs et de principes généraux qui s’imposaient en droit interne, notamment au législateur. Toutefois, au regard de l’importance de la Constitution dans notre hiérarchie des normes et, surtout, de la jurisprudence du Conseil d’Etat, adosser la Charte de l’environnement à la Constitution a permis, non pas tant d’écarter des normes contraires mais de conserver des normes soupçonnées de méconnaître la liberté d’entreprendre. Cette constitutionnalisation a aussi permis d’ouvrir le prétoire du juge du référé-liberté avec, cependant, un nombre de succès qui reste modeste. En second lieu, cette constitutionnalisation a permis de consacrer une nouvelle génération de droits de l’homme à la suite des droits civils (1789) et sociaux (1946). Et donc de renforcer la connaissance et la « visibilité » du droit de l’environnement dans notre société en général et auprès des décideurs publics en particulier. Les articles de doctrine, les colloques, les conférences ont été autant d’occasion de parler de la Charte mais surtout du droit de l’environnement. La rencontre entre les droits de l’homme et le droit de l’environnement s’est poursuivi ensuite, dans le cadre de ce que l’on nomme le « contentieux climatique », notamment devant la cour européenne des droits de l’homme.
Prendre le droit de l’environnement au sérieux. Placé au sein de notre contrat social – le bloc de constitutionnalité – le droit de l’environnement a enfin pu se diffuser dans toutes les branches du droit. Une « pollinisation » des branches du droit en quelque sorte. En premier lieu, la Charte de l’environnement a été invoquée par les plaideurs. Sans doute pas assez mais les centaines de décisions de justice qui sont décelables sur les bases de données juridiques démontrent que le juge administratif mais aussi constitutionnel et judiciaire a bien été interrogé sur l’application et le respect de la Charte. En deuxième lieu, la Charte a également été invoquée au cours des débats parlementaires et certaines lois, mentionnées plus bas, comportent une référence explicite à ce texte. Ce qui tend à démontrer que le législateur fait plutôt attention, non pas toujours à adopter des règles tout à fait favorables à la protection de l’environnement mais, à tout le moins, à ne pas rédiger de dispositions explicitement contraires à la Charte pour prévenir le risque d’une déclaration d’inconstitutionnalité.
Enfin et peut être surtout, la Charte a sans doute eu une portée extra contentieuse.Comme l’a trés bien écrit Michel Prieur : « La Charte de l’environnement est entrée dans les mœurs (…) La Charte va innerver l’ensemble des politiques publiques. Le Grenelle de l’environnement en sera la démonstration. Parallèlement et à petits pas les juges vont se l’approprier. » Il n’existe pas à ma connaissance d’indicateur sur ce point qui permette de vérifier le progrès de cette « entrée dans les mœurs » de la Charte de l’environnement et le propos qui suit est uniquement empirique et personnel. Michel Prieur a toutefois raison d’établir un lien entre la Charte et le Grenelle de I’environnement. Il nous semble en effet qu’à partir de 2005, le droit de l’environnement a enfin été pris au sérieux par les acteurs économiques et politiques. En témoigne l’organisation, en 2007, de ce « Grenelle de l’environnement » suivi du « Grenelle de la mer ». Cette réunion des partenaires sociaux et environnementaux autour de jean-Louis Borloo alors ministre du développement durable, a permis d’interroger la place de l’écologie dans presque toutes les politiques publiques : économie, fiscalité, agriculture, forêt, etc..Certes les suites de ce Grenelle n’ont pas été à la hauteur de l’espoir qu’a suscité cet exercice original de démocratie environnementale. Reste qu’il m’a semblé que le Grenelle a donné le signal à nombre d’acteurs économiques et d’entreprises qu’il était temps de s’informer sur le droit de l’environnement pour en comprendre les exigences mais aussi les opportunités. A partir de cette époque, nombre de cabinets d’avocats ont recruté et associé des avocats en droit de l’environnement et nombre d’entreprises, de cabinets de conseil, de relations publiques ou de communication se sont dotés de département développement durable.
Un chantier à venir : le principe d’intégration. Il reste beaucoup à faire pour assurer l’efficience du droit de l’environnement. A commencer par assurer et garantir les moyens dont disposent les administrations centrales, déconcentrées et décentralisées pour assurer sa mise en œuvre. L’un des chantiers prioritaires à mener tient aussi à l’application du principe d’intégration. Un principe qui existe déjà en droit de l’Union européenne et qui est au cœur des réflexions de Jacques Chirac lorsqu’il lance le chantier de la Charte de l’environnement. Dans sa déclaration prononcée à Avranches sur ses « propositions en matière d’environnement, de développement durable et de lutte contre les pollutions », ce dernier, alors président de la République et candidat à l’élection présidentielle 2002, avait de manière particulièrement juste appelé à ce que l’environnement ne soit plus une politique publique parmi d’autres mais une exigence pour toutes les politiques publiques. Ce passage du discours mérite d’être cité tant il est encore d’actualité :
« La Charte rappellera les droits et les devoirs de chacun à l’égard de l’environnement, et vis-à-vis des générations futures. Elle affirmera cinq principes fondamentaux : principe d’intégration, principe de précaution, principe de responsabilité écologique, principe de prévention, principe d’information et de participation. Il faut un changement d’état d’esprit au sein de toutes les administrations de l’Etat. Il faut un changement de méthode de gouvernement. Dans les années récentes, le ministère de l’environnement a trop souvent servi de caution écologique et l’action n’a pas suivi. Le comité interministériel de l’environnement ne s’est pas réuni depuis cinq ans. Il est temps de mettre fin au dépérissement de la politique de l’environnement. Il n’y aura pas de développement durable tant qu’on se contentera de surajouter une pincée de protection de la nature aux autres politiques publiques, politiques industrielle, agricole, des transports, de l’équipement. On se condamne alors à ne jamais pouvoir infléchir les grandes décisions. L’environnement ne doit plus être pris en compte seulement après que toutes les questions habituellement jugées importantes ont été réglées. Il doit être présent au cur du processus de décision dès l’origine. Tant que l’on aura pas compris cette exigence, on pourra sans doute continuer à parler d’environnement, mais on ne pourra pas parler de développement durable.«
Malheureusement, malgré la création du « super ministère » de l’écologie confié à Jean-Louis Borloo en 2007, l’environnement demeure à la périphérie de l’appareil gouvernemental et administratif de l’Etat. Une variable d’ajustement, un supplément d’âme, une « pincée » mais jamais une priorité. Appliquer le principe d’intégration exigerait notamment que l’environnement soit mieux représenté à Matignon au moyen par exemple de la création d’un poste de vice-premier ministre en charge du développement durable comme le proposait le « pacte écologique » défendu par Nicolas Hulot avant l’élection présidentielle de 2007. Cela exigerait aussi que tout projet de décision publique, élaboré par toute administration soit évalué, en amont et en aval, au regard des objectifs et principes généraux de la Charte. Nous en sommes encore loin tant l’idée demeure vivace que l’écologie n’est pas conciliable avec l’économie. Au demeurant, si Jacques Chirac défendait si bien le principe d’intégration, la Charte n’en a pas fait un principe clé. Il n’est présent qu’à l’article 6 sous une forme très édulcorée : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » En outre, le Conseil constitutionnel a précisé que cet article relatif à l’exigence de promotion du développement durable n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit invocable dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (décision n°2012-283 QPC du 23 novembre 2012).
I. Les grandes dates de l’histoire de la Charte de l’environnement
10 juillet 1976 : promulgation de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, laquelle comporte à son article 1er un début de définition des éléments constitutifs de l’environnement ainsi qu’une consécration « du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit » (article 1er).
15 septembre 1977 : la commission spéciale pour les libertés, présidée par le président Edgar Faure a adopté une proposition de loi constitutionnelle dont l’article 10 disposait : « Tout homme a droit à un environnement équilibré et sain et a le devoir de le défendre. Afin d’assurer la qualité de la vie des générations présentes et futures, l’État protège la nature et les équilibres écologiques. Il veille à l’exploitation rationnelle des ressources naturelles. » De 1977 à 1990, plusieurs amendements et propositions de lois constitutionnelles, présentés par plusieurs groupes parlementaires, ont été déposés dans le but de constitutionnaliser le droit de l’environnement (cf. Nathalie Kosciusko-Morizet, rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle(n°992) relatif à la Charte de l’environnement, Assemblée nationale, 12 mai 2004).
2 février 1995 : promulgation de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Cette loi préfigure la rédaction de la Charte de l’environnement. Elle insère à l’article L.200-1 du code rural l’objectif de développement durable ainsi que les principes généraux du droit de l’environnement qui seront ensuite inscrits en 2005 dans le corps des articles de la Charte. Elle consacre en outre, à l’article L.200-2 du code rural, un droit et un devoir qui seront également repris aux articles 1er et 2 de la Charte : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. /Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. » Ces dispositions ont été transférées du code rural au code de l’environnement à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement.
3 mai 2001 : dans un discours prononcé à Orléans, Jacques Chirac, alors président de la République a fait part de son souhait de voir une Charte de l’environnement adossée à la Constitution : « Alors au nom de cet idéal, l’écologie, le droit à un environnement protégé et préservé, doivent être considérés à l’égal des libertés publiques. Il revient à l’Etat d’en affirmer le principe et d’en assurer la garantie. Et je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le Parlement dans une Charte de l’Environnement adossée à la Constitution et qui consacrerait les principes fondamentaux, cinq principes fondamentaux afin qu’ils soient admis au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et à ce titre bien entendu s’imposant à toutes les juridictions y compris le Conseil Constitutionnel comme ce fut le cas pour le préambule de la Constitution ou la Déclaration des droits de l’Homme« . Ce discours est d’autant plus remarquable que Jacques Chirac ne s’était, jusqu’alors, pas illustré par des prises de position en faveur de la protection de la nature. Moins de trois ans plus tard, cette annonce sera suivie d’effet et la Charte sera effectivement votée par le Congrès puis promulguée.
18 mars 2002 : dans une déclaration prononcée à Avranches sur ses « propositions en matière d’environnement, de développement durable et de lutte contre les pollutions », Jacques Chirac, président de la République et candidat à l’élection présidentielle 2002 a rappelé son attachement à ce qu’une Charte de l’environnement soit adossée à la Constitution : « Je proposerai aux Français d’inscrire le droit à l’environnement dans une Charte adossée à la Constitution, aux côtés des Droits de l’Homme et des droits économiques et sociaux. Ce sera un grand progrès. La protection de l’environnement deviendra un intérêt supérieur qui s’imposera aux lois ordinaires. Le Conseil Constitutionnel, les plus hautes juridictions et toutes les autorités publiques seront alors les garants de l’impératif écologique. Cette démarche est celle de l’efficacité. Elle permettra d’installer la préoccupation, et même parfois la contrainte, de l’environnement dans la durée. Beaucoup d’autres pays ont déjà adopté de telles dispositions.
La Charte rappellera les droits et les devoirs de chacun à l’égard de l’environnement, et vis-à-vis des générations futures. Elle affirmera cinq principes fondamentaux : principe d’intégration, principe de précaution, principe de responsabilité écologique, principe de prévention, principe d’information et de participation. » On notera de nouveau que le principe d’intégration est le premier cité par Jacques Chirac. Et on rappellera que ce principe reste pourtant à écrire et à appliquer.
3 juillet 2002 : dans son discours de politique générale prononcé devant l’Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a rappelé la priorité donnée à l’élaboration de la Charte de l’environnement : « Dans l’esprit des Français, la crainte des catastrophes technologiques et industrielles est à la mesure de leur caractère subit et dévastateur, dont Toulouse porte encore les stigmates et les cicatrices. Une réponse doit y être apportée. C’est le sens du projet de loi sur les risques technologiques qui vous sera proposé à l’automne prochain. Pour transmettre cette exigence aux générations à venir, dans la perspective tracée par le président de la République, une Charte de l’environnement sera élaborée d’ici juin 2003. Elle portera au niveau constitutionnel les principes fondamentaux du développement durable. Les préoccupations environnementales doivent être intégrées comme une dimension essentielle de toutes les politiques publiques. » Si le principe d’intégration n’est pas cité explicitement comme dans les discours précités de Jacques Chirac l’idée est bien présent dans ce discours de son Premier ministre : « Les préoccupations environnementales doivent être intégrées comme une dimension essentielle de toutes les politiques publiques« .
6 avril 2003 : les membres de la commission présidée par le paléontologue Yves Coppens, qui a travaillé pendant un an sur ce texte, ont rendu leur rapport à Roselyne Bachelot, alors ministre de l’écologie et du développement durable. Le texte du rapport est disponible ici. A noter : plusieurs juristes, juges ou avocats, ont contribué aux travaux de cette commission. On citera notamment Delphine Hédary, Marie-Laure Tanon, Christophe Sanson, Laurent Verdier.
27 juin 2003 : le projet de loi constitutionnelle relatif à la protection de l’environnement a été déposé à l’Assemblée nationale (cf. dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale). La ministre de l’écologie et du développement durable était alors Mme Roselyne Bachelot et la députée rapporteure, Nathalie Kosciusko-Morizet qui sera, plus tard, également ministre de l’écologie. L’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle commence par ces mots, qui semblent inspirés du « principe responsabilité » du philosophe Hans Jonas : « L’homme a acquis au XXème siècle un pouvoir sur la nature qu’il n’avait encore jamais exercé et qui remet en cause la relation traditionnelle entre l’humanité et son milieu naturel. Des progrès technologiques exceptionnels alliés à une croissance démographique sans précédent ont fait naître des risques d’exploitation excessive des ressources et de destructions irréversibles du patrimoine naturel. Les conséquences sur le bien-être et la santé des générations présentes et futures peuvent en être très graves. »
28 février 2005 : réunion du Congrès du Parlement et vote de la Charte de l’environnement. Le résultat du scrutin public peut être consulté ici.
1er mars 2005 : promulgation de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. Elle sera publiée au journal officiel du 2 mars 2005. Pour une présentation complète des enjeux et conditions d’élaboration de la Charte de l’environnement, on se reportera avec profit à cet excellent article du professeur Yves Jégouzo, disponible en ligne.
29 avril 2005 : première application de la charte de l’environnement par un juge administratif. Par une ordonnance du 29 avril 2005, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a qualifié le droit à l’environnement, inscrit à l’article 1er de la Charte de l’environnement, de liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté. Il a ainsi suspendu l’exécution de l’autorisation préfectorale d’organisation d’un « teknival » sur le site d’une ancienne base militaire.
3 octobre 2008 : par sa décision n° 297931 du 3 octobre 2008, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a confirmé la valeur constitutionnelle de l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement et précisé la portée de ce texte pour la répartition des compétences entre la loi et le règlement (cf. CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, n°297931).
25 juin 2008 : promulgation de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, laquelle fait référence à la Charte de l’environnement à son article 2 : « La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »
19 juillet 2010 : par une décision n°328687 le Conseil d’Etat a jugé que la légalité d’une autorisation d’urbanisme peut être contrôlée dans sa conformité à l’article 5 (principe de précaution) de la Charte de l’environnement. Cette décision est, à notre sens, particulièrement importante, en ce qu’elle témoigne que les droits, devoirs et principes de la Charte s’imposent bien à l’ensemble des branches du droit (cf. Conseil d’État, 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, n°328687)
13 juillet 2011 : la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique fait explicitement mention de la Charte de l’environnement à son article 1er : « En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. »
27 décembre 2012 : la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement a pour objet de définir les conditions et limites de mise en œuvre du principe de participation inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Elle a été votée en réponse à l’annulation de plusieurs dispositions réglementaires du code de l’environnement
31 janvier 2020 : par une décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, (cf.notre commentaire) le Conseil constitutionnel a identifié un objectif de valeur constitutionnelle relatif à la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, à partir de certaines dispositions du préambule de la Charte de l’environnement (cf. CC, 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques, n°2019-823 QPC).
18 octobre 2024 : par une ordonnance du 18 octobre 2024, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).
II. La philosophie de la Charte de l’environnement
La philosophie de la Charte de l’environnement témoigne bien entendu de celle de ses auteurs, à savoir – principalement – les parlementaires de la majorité présidentielle de Jacques Chirac. Lesquels ont aussi confirmé des choix réalisés de 1976 à 2005, tant en droit interne qu’européen. Deux éléments ressortent plus nettement : le choix d’une « écologie humaniste » et d’une conciliation plutôt que d’une opposition entre écologie et économie, au moyen de l’objectif de développement durable.
Une écologie humaniste. L’expression « écologie humaniste » a été employée par le président Jacques Chirac aux termes de son discours prononcé à Avranches pour qualifier la philosophie de la Charte de l’environnement : « Je suis venu vous dire aujourd’hui, dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle, pourquoi cette exigence est au cœur de mon engagement pour la France. Un engagement pour une écologie humaniste, qui scellera l’alliance de l’environnement, de la science et du progrès économique. Non pas une écologie alibi. Non pas une écologie politicienne et sectaire. Mais une écologie des passionnés de la terre. Une écologie qui fonde une révolution des valeurs, en plaçant avant tout le respect des autres et le respect des libertés de tous » (nous soulignons).
Les sept considérants introductifs de la Charte de l’environnement témoignent de cette écologie humaniste comme source d’inspiration des auteurs de ce texte. Ces considérants nous permettent de comprendre quelle a été l’intention du pouvoir constituant, de mieux interpréter le sens et la portée des articles qui suivent mais aussi de préciser son approche de la protection de l’environnement. Ils ont un point commun : tous font référence à l’homme ou comprennent des termes qui renvient à l’homme et à son organisation sociale : « humanité », « êtres humains », « personne », « société humaine », « Nation », « génération ». Ce qui témoigne certainement de la philosophie humaniste de ce texte : « Le peuple français, / Considérant : / Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; / Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; / Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; / Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; / Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ; / Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; / Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, » (Nous soulignons).
Le rapport de Nathalie Kosciusko-Morizet confirme la philosophie humaniste de la Charte et l’absence de de toute idée de personnification de la nature : « Les sept considérants marquent une progression : partant des questions globales de l’humanité, ils se focalisent progressivement sur les orientations politiques qui doivent guider la nation dans le présent. Comme l’a relevé le professeur Michel Prieur, l’homme ou l’humanité figurent dans six considérants sur sept, illustrant le choix d’une écologie humaniste. En revanche, on ne relève aucune mention suggérant une personnification de la nature, considérée en soi. »
Le dépassement du débat entre « nature » et « environnement ». Outre ce choix d’une écologie humaniste et, d’une certaine manière, « anthropocentrée », les auteurs de ce texte ont choisi de ne pas choisir entre « nature » et « environnement » et ainsi de faire un pas de côté par rapport au débat, ancien et vif au sein du mouvement écologiste, entre « naturalistes » et « environnementalistes ». Les considérants 1, 2 et 5 et font référence aux « ressources », équilibres » et « milieux » naturels tandis que les considérants 3 et 6 comportement le mot « environnement ». Reste que cette supériorité numérique du terme « naturel » ne traduit pas une supériorité d’un autre ordre. L’approche humaniste de la Charte est clairement affirmée au travers, par exemple, d’un considérant ainsi rédigé : « Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains« .
Une troisième génération de droits de l’homme. L’humanisme dont témoigne la Charte de l’environnement se révèle aussi par l’un de ses projets les plus importants : insérer dans notre bloc de constitutionnalité une troisième génération de droits de l’homme. Ainsi que le précise le rapport déposé à l’Assemblée nationale par Nathalie Kosciusko-Morizet, l’intégration de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité témoigne de l’avènement d’une nouvelle génération de droits de l’homme. Cette idée procède plus précisément de l’article 1er de la Charte qui proclame un droit de chacun à vivre dans un environnement sain et équilibré : « Après la garantie des libertés individuelles en 1789 et la protection des droits sociaux en 1946, la perspective s’élargit encore : la Charte se donne pour objet les relations entre l’homme et le monde qui l’environne. » (cf. Nathalie Kosciusko-Morizet, rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle(n°992) relatif à la Charte de l’environnement, Assemblée nationale, 12 mai 2004).
Ce faisant la Charte de l’environnement française a préfiguré un mouvement de rapprochement entre le droit de l’environnement et les droits de l’homme. A titre d’exemple, par une décision « Fondation Urgenda » du 20 décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a jugé d’une part, qu’il existe un consensus scientifique : sur la réalité du changement climatique, sur la contribution des activités humaines à ce changement et sur la pertinence d’un objectif de réduction des émissions de gaz à effet par les pays développés (pays de l’annexe I) de 25 à 40% d’ici à 2020, d’autre part que l’Etat a un « devoir de protection » des citoyens contre les causes et conséquences du changement climatique, au titre des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, enfin que l’Etat a ainsi l’obligation légale de définir un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cohérent le consensus scientifique et avec ses engagements internationaux.
Par un arrêt rendu en Grande chambre le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a consacré, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une obligation positive pour les Etats d’agir pour lutter contre le changement climatique : « 545. En conséquence, l’obligation que l’article 8 impose à l’État est d’accomplir sa part afin d’assurer cette protection. À cet égard, le devoir primordial de l’État est d’adopter, et d’appliquer effectivement et concrètement, une réglementation et des mesures aptes à atténuer les effets actuels et futurs, potentiellement irréversibles, du changement climatique. Cette obligation découle du lien de causalité existant entre le changement climatique et la jouissance des droits garantis par la Convention (…) » (cf. CEDH, 9 avril 2024, affaire Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n°53600/20)
I. La valeur juridique de la Charte de l’environnement
Par une décision n°283103 du 6 avril 2006, le Conseil d’Etat a reconnu la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement et a contrôlé la conformité au principe constitutionnel de précaution d’une disposition réglementaire relative à la chasse : « Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la fixation au premier samedi du mois d’août de la chasse aux oies et aux limicoles sur le domaine public maritime des départements côtiers de la Manche et de l’Atlantique et sur une partie de l’estuaire de la Gironde ne méconnaît pas l’objectif de protection complète fixé par la directive du 2 avril 1979 ; que, par voie de conséquence, elle ne méconnaît pas le principe de précaution formulé dans la Charte de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 110-1 du code de l’environnement » (cf. Conseil d’État, 6 avril 2006, Ligue pour la protection des oiseaux, n°283103).
Par une décision n°278942 du 15 mai 2006, le Conseil d’Etat a jugé qu’un requérant ne peut pas demander invoquer la méconnaissance de la Charte de l’environnement – ici son article 7 – par un décret intervenu antérieurement à son entrée en vigueur : « Considérant que la Charte de l’environnement de 2004, dont le contenu est défini à l’article 2 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, n’était pas en vigueur à la date à laquelle le décret attaqué a été adopté ; qu’ainsi, et en tout état de cause, l’association requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de cette Charte par le décret attaqué » (cf. Conseil d’Etat, 15 mai 2006, Association des riverains de la ligue des Carpates, n°278942)
Par une décision n°282456 du 19 juin 2006, le Conseil d’Etat a jugé que la légalité des dispositions réglementaires prises en application des dispositions législatives prises pour l’application de la Charte de l’environnement doit être contrôlée par rapport à ces dernières « sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte » (cf. Conseil d’État, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, n°282456)
Par une décision n°293764 du 13 juillet 2006, le Conseil d’Etat a contrôlé la conformité d’un décret relatif à la chasse au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la fixation au premier samedi du mois d’août de la chasse aux oies, canards, rallidés et limicoles sur le domaine public maritime des départements côtiers de la façade maritime de l’Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, sur une partie de l’estuaire de la Gironde et sur certains étangs de la Gironde et des Landes ne méconnaît pas l’objectif de protection complète fixé par la directive du 2 avril 1979 ; que, par voie de conséquence, elle ne méconnaît pas le principe de précaution formulé dans la Charte de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; » (cf. Conseil d’Etat, 13 juillet 2006, Association France nature environnement, n°293764).
Par sa décision n° 297931 du 3 octobre 2008, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a confirmé la valeur constitutionnelle de l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement et précisé la portée de ce texte pour la répartition des compétences entre la loi et le règlement (cf. CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, n°297931) :
- L’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle et s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs : « Considérant que l’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que » la loi détermine les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement » ; qu’il est spécifié à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que » Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » ; que ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; »
- Lorsque la Charte de l’environnement le précise, les « conditions et limites » des droits qu’elle comporte doivent être définies par le législateur et non par le pouvoir réglementaire : « Considérant que les dispositions précitées, issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser » les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; qu’en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur ; que, toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi ; »
- Les « conditions et limites » du principe de participation consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement doivent être définies par le législateur : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, depuis la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement que pour l’application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte«
Par sa décision n°305314 du 24 juillet 2009, le Conseil d’Etat a confirmé que les conditions et limites des droits et et devoirs des articles 3 (devoir de prévention) et 7 (droit d’accès à l’information) de la Charte doivent être définies par le législateur. Une loi donnant compétence au pouvoir réglementaire pour définir les conditions et limites du droit d’accès à l’information environnementale, consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement, doit être considérée comme abrogée à la date d’entrée en vigueur de la Charte (cf. CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique, n°305314).
Par une décision n°344522 du 12 juillet 2013, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a jugé que le juge administratif est compétent pour contrôler la conformité à la Charte de l’environnement – ici l’article 3 relatif au principe de prévention – de dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi : « 12. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 11 que la conformité au principe énoncé par l’article 3 de la Charte de l’environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d’une atteinte à l’environnement, ou de l’absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution ; qu’en revanche, il appartient à celui-ci, au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l’application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n’ont pas elles-mêmes méconnu ce principe » (cf. CE, ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n°344522)
IV. Le contenu de la Charte de l’environnement
La Charte de l’environnement, ainsi que le souhaitait le rapport de la commisison Coppens, est composée
- de grands objectifs : l’objectif de développement durable, l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains.
- de droits et devoirs : droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.(article 1er) ; devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (article 2) ; devoir de toute personne de prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences (article 3) ; devoir de toute personne de contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement (article 4) ; droit d’accès à l’information environnementale et de participation (article 7).
- d’objectifs et de principes de mise en oeuvre : principe de précaution (article 5) ; objectif de développement durable et de conciliation (article 6) ; éducation et formation à l’environnement (article 8) ; recherche et innovation (article 9) ; verdissement de l’action européenne et internationale de la France (article 10).
A. Les grands objectifs de la Charte de l’environnement
La Charte de l’environnement se caractérise aussi par le choix de concilier et non d’opposer écologie et économie. Ce choix est décrit à l’article 6 : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » (nous soulignons). Ce choix de concilier économie et écologie se traduit donc, dans la Charte, par l’inscription de l’objectif de promotion du développement durable. Lequel permet d’associer la réflexion sur l’écologie à celle sur le social et l’économie. A noter : cet objectif est également inscrit dans la loi. Aux termes des II et III de l’article L.110-1 du code de l’environnement, la recherche d’un développement durable est sans doute l’objectif fondamental du droit de l’environnement. Un objectif désormais confirmé dans le bloc de constitutionnalité comme le rapport de la commission Coppens l’appelait de ses voeux, tout en faisant le lien entre le développement durable et la nouvelle génération de droits de l’homme : « La démarche retenue par la Commission inscrit la Charte de l’environnement dans un objectif de développement durable, d’un double point de vue. La Charte de l’environnement est tout d’abord un troisième temps dans l’affirmation des droits et libertés fondamentales, après la consécration des droits civiques et politiques en 1789, puis celle des droits économiques et sociaux en 1946. Elle complète ainsi le triptyque du développement durable, au sens de sa définition internationale proposée par le rapport Brundtland en 1987, en ajoutant le pilier environnemental. Ainsi, elle créera un nouvel équilibre entre développement économique, progrès social et protection de l’environnement. »
La Charte de l’environnement est, dans son ensemble, largement inspirée des termes de l’article L.110-1 du code de l’environnement. Rappelons que la rédaction de cet article a pour origine l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, assez largement modifié par l’article 1er de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Rappelons aussi que le contenu de cet article L.110-1 a d’abord été placé au sein du code rural avant la création du code de l’environnement. Le II de l’article L.110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction actuelle est ainsi rédigé, à propos des éléments constitutifs de notre environnement et fait explicitement référence à l’objectif de développement durable : « II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » (Nous soulignons). Le lien entre l’objectif de développement et le souci des besoins des générations futures est donc bien établi. Le III de ce même article L.110-1 énonce les cinq engagements à respecter pour réaliser cet objectif.
Par une décision n°459387 du 28 février 2022, le Conseil constitutionnel a identifié les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé qui doivent être conciliés avec la liberté d’entreprendre : « 4. En deuxième lieu, s’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, c’est à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. (…) Il suit de là qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas, compte tenu du champ de cette obligation, manifestement déséquilibrée, entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté« . (cf. CE, 28 février 2022, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole et autres, n°459387)
Par une décision n°2023-848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel a précisé que la simplification législative de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour les projets d’installations renouvelables et de stockage d’énergie réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur visent à favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie. Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement (cf. CC, 9 mars 2023 – Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n°2023-848 DC et notre commentaire).
B. Les articles de la Charte de l’environnement
Les développements qui suivent ont pour seul objet de présenter quelques unes des principales décisions relatives à la Charte de l’environnement, rendues par le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel.
Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
L’application de l’article 1er de la Charte de l’environnement par le juge administratif du référé-liberté. Par une ordonnance du 29 avril 2005, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a qualifié ce droit à l’environnement de liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté cf. TA Châlons-en-Champagne, ord. 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel et a. c/ préfet de la Marne, n°0500828;0500829;0500830)
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a jugé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré à l’article 1er de la Charte présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif à la procédure du référé-liberté (cf. CE, ord., 20 septembre 2022, n°451129).
Par une ordonnance n°2208000 du 5 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l’exécution d’une autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, accordée pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque. Il a en effet souligné, à titre principal, que le projet de centrale solaire contesté a donné lieu, outre l’autorisation de dérogation, à un permis de construire et une autorisation de défrichement que l’association requérante n’a pas contestés et qui sont devenus définitifs. Plus largement, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a souligné que l’office du juge du référé-liberté ne saurait se être confondu avec celui du juge de l’excès de pouvoir. (cf. TA Marseille, ord, 5 octobre 2022, n°2208000).
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a confirmé que le droit à un environnement sain et équilibré consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il a, sur ce fondement, suspendu l’exécution de l’arrêté autorisant la chasse du Lagopède alpin, cet arrêté « étant de nature à compromettre, pour une espèce particulièrement fragile, les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution » (cf. CE, ord.,18 octobre 2024, comité écologique ariégeois, n°498433).
L’application de l’article 1er de la Charte de l’environnement par le juge administratif du fond. Par une décision n°497567 du 9 décembre 2024, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (article L.411-2 du code de l’environnement). Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré que la question de la conformité à la Constitution – articles 1et 3 de la Charte de l’environnement – de la mesure par laquelle la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023 a limité la possibilité de contester le caractère d’intérêt public majeur d’un projet présente un caractère nouveau et sérieux (cf. CE, 9 décembre 2024, association « Préservons la forêt des Colettes » et autres, n°497567).
L’application de l’article 1er de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel. Par sa décision n°2022-843 DC du 12 août 2022, (cf. notre commentaire) le Conseil constitutionnel a élargi la portée du droit à environnement sain et équilibré, consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement, en en combinant le contenu avec celui de plusieurs dispositions du préambule de ladite Charte. Il a ainsi précisé que le respect par le législateur du droit à l’environnement consacré à l’article 1er de la Charte de l’environnement impose la recherche d’un double équilibre : d’une part, un équilibre entre la préservation de l’environnement et les autres intérêts fondamentaux de la Nation et, d’autre part, un équilibre entre les besoins des générations présentes et ceux des générations futures.
Par une décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023 (cf. notre commentaire) le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 25 juillet 2016 relatives à la réversibilité du stockage géologique en couche profonde de déchets radioactifs. Aux termes de cette décision, il a procédé à l’interprétation du droit à environnement sain et équilibré – définit à l’article 1er de la Charte de l’environnement – éclairé à la lumière du septième alinéa de cette Charte relatif aux capacités des générations futures et des autres peuples.
- Il n’existe qu’un seul droit à un environnement sain et équilibré qui est celui des générations actuelle, futures et des autres peuples.
- La garantie de ce droit réside notamment dans l’obligation faite au législateur de répartir la charge d’un projet entre les générations.
- Au cas d’espèce, l’autorisation du stockage géologique des déchets radioactifs en couche profonde est susceptible de porter atteinte à l’exercice du droit à un environnement sain et équilibré, ainsi interprété.
- La disposition créant un tel risque d’atteinte est, toutefois, légale – ou constitutionnelle – en raison des garanties définies par le législateur.
- Ces garanties doivent permettre de limiter les atteintes au droit à un environnement sain et équilibré mais aussi de repartir la charge des effets des projets ayant incidence pour l’environnement, entre générations. (cf. CC, 27 octobre 2023 – Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs], n°2023-1066 QPC)
Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Cet article est particulièrement intéressant en ce qu’il créé, à la charge de toute personne, un devoir, non seulement de préservation mais aussi d’amélioration de l’environnement.
Par une décision n°330566 du 3 août 2011, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 2 de la Charte de l’environnement ne donne pas intérêt à agir à toute personne pour demander l’annulation de toute décision administrative devant le juge administratif : « (…) que l’article 2 de la Charte de l’Environnement, selon lequel » toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement « , ne saurait, par lui-même, conférer à toute personne qui l’invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de toute décision administrative qu’elle entend contester (…)« (cf. CE, 3 août 2011, n°330566).
A noter : le Conseil constitutionnel de consacrer, sur le fondement de cet article 2 de la Charte de l’environnement et du devoir de toute personne de prendre part à l’amélioration de l’environnement, un principe de non régression. A la suite de sa saisine parlementaire aux fins de contrôle de constitutionnalité a priori des dispositions de la loi « relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières », dite loi « néonicotinoïdes », 14 juristes spécialisés en droit de l’environnement (professeurs, maîtres de conférence, avocats) – dont l’auteur de ces lignes – ont adressé le 13 novembre 2020 une « contribution extérieure » au Conseil constitutionnel pour l’encourager à identifier ce principe de non régression. Cette analyse a été écartée par le Conseil constitutionnel. En l’état de sa jurisprudence, seule une révision de la Constitution permettrait d’inscrire ce principe au sein de la Charte (cf. CC, 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, n°2020-809 DC).
Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Par une décision n°344522 du 12 juillet 2013, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a fait application de l’article 4 de la Charte de l’environnement et jugé que plusieurs dispositions réglementaires relatives à la gestion et à la pêche de l’anguille ne méconnaissaient pas le principe énoncé dans cet article : « 14. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la Charte de l’environnement : » Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi » ; que les dispositions contestées du décret attaqué, qui n’affectent nullement les conditions dans lesquelles toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, ne sauraient être regardées comme méconnaissant le principe énoncé par cet article » (cf. CE, ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n°344522)
Par une décision n°2020-881 du 5 février 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à l’article 4 de la Charte, les dispositions de l’article 1247 du code civil (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) qui écartent l’obligation de réparation du préjudice écologique consécutif à des atteintes qui présentent un caractère négligeable (cf. CC, 5 février 2021 – Association Réseau sortir du nucléaire et autres [Définition du préjudice écologique réparable], n°2020-881 QPC)
Article 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Par une décision n°318584 du 2 septembre 2009, le Conseil d’Etat a jugé que la décision du ministre de l’intérieur, de doter la police nationale de pistolets à impulsion électrique n’affecte pas l’environnement. Partant, il n’est pas nécessaire de vérifier sa conformité à l’article 5 (principe de précaution) de la Charte de l’environnement : « Considérant, d’une part, que la décision attaquée n’affecte pas l’environnement au sens de l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence ; que, par suite, l’Association réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions constitutionnelles » (cf. Conseil d’État, 2 septembre 2009, Association réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme, n°318584).
Par une décision n°328687 du 19 juillet 2010, le Conseil d’Etat a jugé que la légalité d’une autorisation d’urbanisme peut être contrôlée dans sa conformité à l’article 5 (principe de précaution) de la Charte de l’environnement: « Considérant qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dernières dispositions qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que, dès lors, en estimant que le principe de précaution tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut être pris en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit ; que l’Association du quartier Les Hauts de Choiseul est, dès lors, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque » (cf. Conseil d’État, 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, n°328687) (nous soulignons).
Par une décision n°326492 du 26 octobre 2011, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a jugé que le principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions » (cf. Conseil d’État, Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n°326492)
Par une décision n°2013-346 du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC relative à la loi du 13 juillet 2011 d’interdiction de la fracturation hydraulique, a décidé qu’est inopérant le grief tiré de ce que l’interdiction pérenne du recours à tout procédé de fracturation hydraulique de la roche pour l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux méconnaîtrait le principe de précaution ; (cf. CC, 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches], n°2013-346 QPC)
Par une décision n°23 octobre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que le juge administratif est en droit d’exercer un contrôle entier et non un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation, pour statuer, au vu des éléments portés à sa connaissance, sur l’existence de risques pour l’environnement et pour la santé liés à l’utilisation du Roundup Pro 360 susceptibles de justifier l’application du principe de précaution et prononcer, en application de ce principe, l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché de ce produit phytopharmaceutique. (cf. CE, 23 octobre 2024, société Bayer Seeds, n°456108)
Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
L’article 6 relatif à l’exigence de promotion du développement durable n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit invocable dans le cadre d’une QPC (décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012). En contrôle a priori, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur de déterminer les modalités de la mise en œuvre de cette disposition (décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013).
Par une décision n°2013-346 du 11 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a confirmé que l’article 6 de la Charte de l’environnement n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution (cf. CC, 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches], n°2013-346 QPC)
Par une décision n°353577 du 16 avril 2012, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L 553-1 du code de l’environnement qui soumet les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Pour la Haute juridiction administrative, cet article L. 553-1 ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, non plus que le principe de promotion du développement durable énoncé à l’article 6 de la Charte de l’environnement (cf. Conseil d’État, 16 avril 2012, Société Innovent, n°353577)
Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Les décisions de renvoi de QPC par le Conseil d’Etat. Par une décision n°340512 du 18 juillet 2011, le Conseil d’Etat a jugé que le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 portant création du « Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement » n’a pas été pris pour la mise en œuvre du principe de participation du public inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Partant, il n’est pas nécessaire de vérifier s’il a été pris par une autorité incompétente – en l’occurrence le pouvoir réglementaire : « Considérant les dispositions du décret attaqué, qui n’ont pas pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement consacré par l’article 7 de la Charte de l’environnement, mais concernent un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des engagements du » Grenelle de l’environnement « , ne relevaient pas de la compétence du législateur ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret a été pris par une autorité incompétente doit être écarté » (cf.CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs, n°340512).
Par une décision n°340539 du 18 juillet 2011, le Conseil d’État renvoyé au Conseil constitutionnel la question (QPC) de la conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement de l’article L.511-2 du code de l’environnement relatif au régime de l’enregistrement des ICPE (cf. CE, 18 juillet 2011, Association France Nature Environnement, n°340539)
Par une décision n°340551 du 18 juillet 2011, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question (QPC) de la conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement du III de l’article L. 512-7 du code de l’environnement relatif au régime de l’enregistrement des ICPE (cf. CE, 18 juillet 2011, Association France nature environnement, n°340551).
Par une décision n°349657 du 18 juillet 2011, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question (QPC) de la conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement de l’article L. 321-5-1 du code forestier, qui institue une servitude de passage et d’aménagement des voies de défense contre l’incendie (cf. Conseil d’État, 18 juillet 2011, M.A, n°349657).
Par une décision n°356349 du 17 avril 2012, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question (QPC) de la conformité à la Charte de l’environnement de la dernière phrase du 1er alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement qui prévoie que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées relevant du régime de l’autorisation que le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (cf. CE, 17 avril 2012, Association France nature environnement, n°356349)
Les décisions QPC du Conseil constitutionnel. Par une décision n°2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, les dispositions de la loi loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre relatives à la procédure de concertation pour l’élaboration des chartes départementales d’engagements relatifs à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation. La portée de cette décision dépasse de loin le sujet des pesticides. Le Conseil constitutionnel a,
- d’une part, qualifié les chartes départementales d’engagements relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) de « décisions ayant une incidence sur l’environnement »
- d’autre part, précisé que les modalités de concertation relatives à l’élaboration de ces chartes sont contraires au principe de participation du public inscrit à l’article 7 de la Charte de l’environnement (cf. CC, 19 mars 2021, Association Générations futures et autres [Participation du public à l’élaboration des chartes d’engagements départementales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques], Décision 2021-891 QPC).
Les décisions au fond du Conseil d’Etat. Par une décision n°468106 du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pris pour l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement imposent que la personne publique concernée mette à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement mais n’imposent en revanche pas que cette consultation ne puisse intervenir qu’une fois rendus tous les avis des instances techniques et scientifiques dont la consultation est obligatoire en vertu des textes, ni que les avis qui auraient déjà été recueillis lorsque la procédure de participation du public est mise en œuvre soient joints aux éléments mis à la disposition du public (cf. CE, 6 novembre 2024, Association Bloom, n°468106).
Par une décision du 18 novembre 20204, le Conseil d’Etat a jugé que le défaut de publication de la synthèse des observations et propositions du public à la date de publication du décret attaqué est, par lui-même, sans incidence sur sa légalité de ce décret, de même que l’absence de publication, dans le décret lui-même ou dans un document séparé, des motifs de ce dernier (cf. CE, 18 novembre 2024, n°465266).
Par une décision n°492185 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que si les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement pris pour l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement « impliquent que ces projets d’acte fassent l’objet d’une publication préalable permettant au public de formuler des observations, elles n’imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public« . A contrario, il y a lieu de se demander si cette jurisprudence impose désormais l’organisation d’une nouvelle procédure de participation du public lorsque le projet qui a été soumis à ce dernier a été modifié de telle manière qu’il en est « dénaturé » (cf. CE, 20 décembre 2024, Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques, n°492185)
Les décisions DC du Conseil constitutionnel. Dans le cadre de son contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi, le Conseil constitutionnel a également rendu plusieurs décisions qui intéressent l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Par une décision n°2023-851 DC du 21 juin 2023, le Conseil constitutionnel a précisé qu’une disposition législative ne constitue pas une décision publique au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le grief tiré de l’absence de procédure de participation du public à l’élaboration d’une telle disposition ne peut dès lors qu’être écarté (cf. CC, 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, n°2023-851 DC)
Article 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Par une décision n°487936 du 19 novembre 2024, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à l’article 8 de la Charte de l’environnement des dispositions des articles L.413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement relatives à la présentation d’animaux sauvages au public par des établissements de spectacles. Le Conseil constitutionnel ne s’est encore jamais prononcé sur le sens et la portée de cet article 8 (cf. CE, 19 novembre 2024, Association One Voice France, n°487936)
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : un « stress-test » pour la Charte de l’environnement à l’occasion de son 20ème anniversaire (loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur »)
Ce 8 juillet 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" dite "Loi Duplomb" du nom du sénateur Laurent Duplomb qui a déposé la version initiale de ce texte. Celui-ci...
Recours administratif : abandon de la prise en compte de la date de réception au profit de la date d’expédition pour les délais de recours (Conseil d’Etat)
Par une décision du 30 juin 2025, n°494973, le Conseil d’Etat a simplifié la règle de calcul du délai à respecter pour l'introduction, par voie postale, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision administrative. Le principe est...
Rapport 2025 du Haut conseil pour le climat : le changement climatique accélère mais l’Etat ralentit
Le Haut conseil pour le climat, créé en 2019 à l'initiative du Président de la République et composé de douze experts indépendants vient de publier son nouveau rapport annuel. Un rapport qui pointe le ralentissement de notre rythme de réduction des émissions de gaz à...
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Sénat confirme l’affaiblissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la suppression des objectifs sectoriels de développement des énergies renouvelables
Ce mardi 1er juillet 2025, en deuxième lecture et en commission, les sénateurs ont examiné la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si les sénateurs ont supprimé la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : l’Assemblée nationale rejette la proposition de loi mais le risque d’un « moratoire light » sur les énergies renouvelables demeure
Ce mardi 24 juin 2025, les députés doivent se prononcer, lors du vote solennel, pour ou contre la proposition de loi du sénateur Gremillet portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Si le texte est rejeté par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.