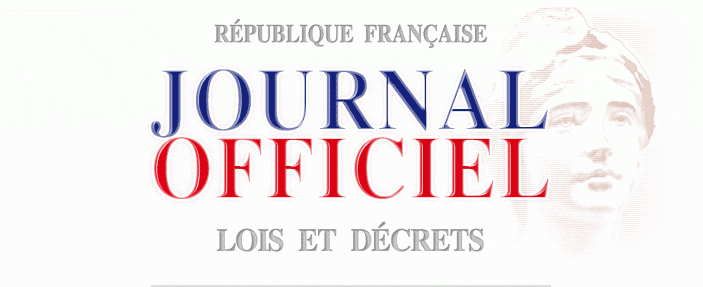En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Projet de loi de simplification de la vie économique : les députés débattent de la simplification du droit de l’environnement et du projet d’autoroute A 69
A compter de ce mardi 8 avril 2025, les députés examinent en séance publique et en première lecture le projet de loi de simplification de la vie économique. Ce texte comporte, notamment de nombreuses dispositions destinées à « simplifier » le droit de l’environnement. Dont une qui pourrait avoir pour effet de revenir sur l’annulation par le tribunal administratif de Toulouse, le 27 février 2025, de l’autorisation environnementale du projet d’autorisation environnementale d’autoroute A69. Analyse.
La liste des principales dispositions de ce projet de loi comportant des mesures de simplification du droit de l’environnement est la suivante :
- La réduction du droit pour une association de former un recours contre une autorisation d’urbanisme (article 12 bis A)
- La simplification des conditions de délivrance de la « dérogation espèces protégées » (articles 15 bis A et 20 bis AB). Article 15 bis A : création d’une liste récapitulative des projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Article 20 bis AB : la déclaration d’utilité publique des projets d’infrastructures vaut reconnaissance de leur raison impérative d’intérêt publique majeure.
- La dispense d’évaluation environnementale pour un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique (article 15 bis C)
- La suppression d’une partie de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols (article 15 bis D)
- La suppression des zones à faible émission – mobilité (ZFE) (Article 15 ter)
- La modification de l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité des mesures de compensation de la biodiversité (article 18)
- La programmation pluriannuelle de l’énergie sera définie par une loi, à voter avant le 1er juillet 2026 (article 21 quater)
I. La réduction du droit pour une association de former un recours contre une autorisation d’urbanisme (article 12 bis A)
Cet article comporte une mesure assez importante de modification du code de l’urbanisme qui intéresse aussi le contentieux de l’environnement. Cet article créé en effet une nouvelle condition de recevabilité du recours contre une autorisation d’urbanisme, devant le juge administratif.
Cette condition n’était imposée jusqu’à présent qu’aux personnes autres que : l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association. Les personnes physiques et les autres personnes morales devaient en effet démontrer que la construction litigieuse affecte directement l’occupation, l’utilisation ou la jouissance d’un bien détenu ou occupé par elles. Cette condition est désormais aussi imposée à « toute personne physique ou morale » et donc aussi à une association.
Pour mémoire, dans leur rédaction actuelle, les articles L.600-1-1 et L.600-1-2 du code de l’urbanisme subordonnent le dépôt d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme à plusieurs conditions :
- L’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme conditionne la recevabilité du recours d’une association contre au dépôt de ses statuts de l’association en préfecture, au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
- L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme conditionne la recevabilité du recours contre une autorisation d’urbanisme, formé par « une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association » à la preuve que « la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.«
L’article 12 bis A du projet de loi de simplification de la vie économique :
- d’une part, fusionne, au sein de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme, la rédaction des articles L.600-1-1 et L.600-1-2 du code de l’urbanisme
- d’autre part modifie la rédaction de la disposition – aujourd’hui inscrire à l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : « Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisés sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente ou de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation«
Si cette réforme est définitivement adoptée et si sa constitutionnalité n’est pas critiquée par le conseil constitutionnel, elle aurait pour effet de réduire sans doute considérablement le nombre des recours déposés par une association. Mais…. elle n’aurait pas nécessairement pour effet de réduire sensiblement le nombre total des recours déposés contre les autorisations d’urbanisme. La réduction du nombre des recours déposés par des associations pourra en effet être compensé par l’augmentation des recours déposés par des personnes physiques. Les riverains opposés à un projet de construction et organisés en association seront simplement encouragés à déposer un recours en leur nom propre et non au nom de l’association.
II. La simplification des conditions de délivrance de la « dérogation espèces protégées » (articles 15 bis A et 20 bis AB)
La procédure de délivrance de l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’en finit pas de susciter des propositions de mesures de simplification.
Article 15 bis A : création d’une liste récapitulative des projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cet article est issu de l’amendement n°XX. Il ne créé pas de nouvelle règle de droit mais se borne à créer une liste des projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Les six premiers alinéas de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement seraient alors ainsi rédigés :
« Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 :
1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique remplissant les conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;
2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;
3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national en application de l’article L. 102‑12 du même code ;
4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en application de l’article L. 350‑1 dudit code ;
5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Article 20 bis AB : la déclaration d’utilité publique des projets d’infrastructures vaudra reconnaissance de leur raison impérative d’intérêt publique majeure. Les députés ont adopté en commission, ce 26 mars 2025, un amendement, notamment défendu par M. Jean Terlier, qui est l’un des principaux partisans du projet de construction de l’autoroute A 69. Un projet dont l’autorisation environnementale a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement rendu ce février 2025 (cf. notre commentaire).
Pour mémoire, le député Jean Terlier et trois autres parlementaires avaient annoncé, à la suite de ce jugement, le dépôt d’une proposition de loi de validation de l’autorisation environnementale annulée par le tribunal administratif de Toulouse. Cette proposition de loi n’a, à ce jour, pas été déposée, peut-être en raison des risques politiques et juridiques qu’elle comporte. Une autre stratégie a sans doute été décidée. A savoir : inscrire une mesure dans le projet de loi de simplification de la vie économique qui ne constitue pas à proprement parler une mesure de validation mais qui pourrait considérablement augmenter les chances de succès de l’appel déposé par l’Etat devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
L’amendement précité comporte une disposition qui retient l’attention puisqu’elle prévoit que tous les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il ne s’agit plus de créer une présomption mais bien de prévoir dans la future loi que tout projet déclaré d’utilité publique satisfait à la première des trois conditions pour bénéficier d’une « dérogation espèces protégées ».
L’amendement est ainsi rédigé :
« III. – Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
L’exposé des motifs de l’amendement parle bien sûr du projet routier A69 (et aussi contournement de Beynac). Mais sans préciser si cette disposition a pour but explicite de neutraliser le jugement du tribunal administratif de Toulouse et de « rétablir » l’autorisation environnementale.
Si l’on formule l’hypothèse que cette disposition est d’application immédiate et a bien été rédigée pour amener la cour administrative d’appel de Toulouse a annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse : l’Etat pourrait ainsi se prévaloir – devant elle – de cette loi et du caractère non définitif du jugement frappé d’appel pour soutenir que la légalité de l’autorisation environnementale de l’A69 ne peut plus être contestée en tant qu’elle reconnaît la raison impérative d’intérêt public majeure du projet. Dans ce cas, la cour administrative d’appel de Toulouse pourrait contrôler la légalité du reste de l’autorisation environnementale mais il faut admettre que les débats ont toujours porté sur la raison impérative d’intérêt public majeur.
En résumé : le vote de cette disposition augmente les chances de succès de l’appel formé par l’Etat contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Si cette hypothèse se vérifie : cette mesure serait une mesure de validation qui ne dit pas son nom.
III. La dispense d’évaluation environnementale pour un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique (article 15 bis C)
Cet article 15 bis C prévoit d’insérer un nouvel article L. 300‑6‑2‑1 au sein du code de l’urbanisme. Le principe de cette dérogation à l’obligation d’évaluation environnementale est ainsi défini au I de ce nouvel article L.300-6-2-1:
« I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section 1 du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.«
Toutefois, cette dérogation à l’obligation d’évaluation environnementale est subordonnée au respect de très nombreuses conditions qu’il n’est pas certain que la mise en œuvre de la dérogation soit plus simple que celle de l’obligation elle-même.
IV. La suppression d’une partie de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols (article 15 bis D)
Le projet de loi de simplification de la vie économique comporte plusieurs dispositions de nature à réduire – de nouveau – le sens et la portée de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, actuellement inscrit à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Pour l’heure, cet objectif est double :
- réduire de moitié le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix ans suivant la promulgation de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 ;
- parvenir à une absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
L’article 15 bis D du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de réécrire de la manière suivante cet article 191 dans le but de supprimer la première branche de l’objectif, à savoir la réduction de moitié de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols :
« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;
Ces objectifs Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis aux échelles régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.«
V. La suppression des zones à faible émission – mobilité (ZFE) (Article 15 ter)
Cet article abroge ou supprime les articles du code des transports, du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement qui sont actuellement consacrés au régime juridique des ZFE :
- Les articles L. 2213‑4‑1 et L.2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
- L’article L.1115‑8‑1 code des transports est abrogé.
- Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est supprimé
- Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est supprimé.
Pour une présentation du régime juridique actuel des zones à faibles émissions : notre article.
VI. La modification de l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité des mesures de compensation de la biodiversité (article 18)
Cet article 18 a pour objet de permettre que l’objectif de perte nette voire de gain de biodiversité des mesures de compensation ne soit réalisé qu’au terme d’un délai défini par l’autorité administrative sur proposition du porteur de projet et non sur toute la durée des atteintes, et donc dés la mise en serve dudit projet.
L’objectif est donc conservé mais ses conditions de réalisation sont assouplies.
Cet article 18 prévoit, principalement, de modifier la rédaction de l’article L.163-1 du code de l’environnement de la manière suivante :
« I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.«
VII. La programmation pluriannuelle de l’énergie sera définie par une loi, à voter avant le 1er juillet 2026 (article 21 quater)
L’article 21 quater du projet de loi procède de l’amendement déposé par le député Henri Alfandari. Le 26 mars 2025, les députés ont adopté en commission cet amendement CS509 sur le projet de loi de simplification de la vie économique. Son objet est de faire remonter au niveau de la loi le contenu de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
- d’une part, cet amendement prévoit l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie avant le 1er juillet 2026. L’article L. 100‑1 A du code de l’énergie disposera alors : « I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes. / Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.«
- d’autre part, cet amendement abroge les articles L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4, L. 141‑5, et L. 141‑6 du code de l’énergie. Rappelons que l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoit la publication d’un décret PPE.
En définitive, si cet amendement devait être conservé : toute la programmation pluriannuelle de l’énergie sera organisée par la loi – à la suite donc de débats parlementaires – et non par décret. Pour une présentation complète de cette disposition : notre article.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique
La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation. Résumé Selon...
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
Le 1er janvier 2026, a été publié au Journal officiel, le décret relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Pour rappel, le mécanisme de capacité a été créé pour garantir le maintien en fonctionnement de capacités...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.